Le temps long du capitalisme
Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XVe et XVIIIe siècles), tome 1 : Les structures du quotidien, Paris, Armand Colin, 1967
Chapitre 1 : Le poids du nombre
À l'échelle du monde l'homme a triomphé des multiples obstacles qui s'opposaient à sa progression numérique, sur l'ensemble des terres qu'il occupait. Vers 1300, 69 millions d'Européens et après la peste noire en 1450, 55 millions d'habitants, et en 1600 on peut envisager 100 millions d'Européens.
Entre le 15e et le 18e siècle le monde n'est encore qu'une immense paysannerie, 80 à 90 % des hommes vivent de la terre.
Les pertes dues aux guerres, aux expulsions (Maurisques, protestants, etc.) ou au peuplement du nouveau monde, pose un problème à l’Europe, laquelle n'est pas capable de se délester davantage d'hommes. À cette époque une grande puissance (l'empire ottoman, l'empire hispanique, où la France de Louis XIII et de Richelieu) compte environ 17 millions d'hommes. Une population en France en surnombre par rapport à ses capacités. (36)
Sous l'ancien régime les coefficients de natalité et mortalité sont voisins l'un de l'autre : ce qui permet l'équilibre (ce que la vie apporte la mort le reprend). La famille ne cesse de ravager le continent.
Les villes se protègent, contre les invasions régulières (lesquelles mettent en branle de véritables armées de pauvres venues parfois de fort loin). (56)
La misère s'aperçoit notamment dans l'alimentation avec la persistance des bouillies, et des soupes dans l'alimentation populaire avec le pain mélangé de farines secondaires. En plus de la malnutrition, les hommes doivent faire face aux maladies. « Sur ce double plan, l'homme d'ancien régime est constamment en situation précaire. » (69)
Mais si l'on veut résumer la tendance, les compensations viennent de façon insensible mais finalement ont le dernier mot. Car c'est le nombre qui partage, et organise le monde. Les civilisations jouent et gagnent. Elles gagnent sur les peuples primitifs, elles gagnent aussi sur l'espace vide : espace américain Sibérie Australie Nouvelle-Zélande… (76) Exploitation économique des autres : la civilisation domine la culture (79).
La vie matérielle trouve donc une de ses explications régulières dans la force du nombre dans le simple jeu de ses forces : l'Europe est incompréhensible sans ses esclaves et ses économies sujettes (il en va de même pour la Chine).
Chapitre 2 : Le pain de chaque jour
Entre le 15e et le 18e l'alimentation des hommes consiste pour l'essentiel en nourritures végétales. Trois d'entre elles ont connu une fortune éclatante, le blé, le riz, le maïs. Ce sont des plantes de civilisation qui ont « organisé la vie matérielle et parfois psychique des hommes très en profondeur, au point de devenir des structures à peu près irréversibles. » (84) En terme de calories produites, Les nourritures végétales montrent leur supériorité. Et c'est par exemple la double récolte de riz qui permet à la Chine du Sud sa lente montée démographique à partir du 13e siècle. Le maïs montre sa très grande productivité et donc des paysans libres, trop libres. On observe ainsi l'émergence de société denses, oppressives, des États théocratiques, tyranniques, où tous les loisirs campagnards sont utilisés pour d'immenses travaux égyptienne. « Sans le maïs, rien n'eût été possible des pyramides géantes des Mayas ou des Aztèques, des murs cyclopéens du Cuzco ou des merveilles impressionnantes de Machu Picchu. Il a fallu, pour les construire, que le maïs en somme, se fabrique tout seul, ou presque. » (133)
Chapitre 3 : Le superflu et l'ordinaire : nourritures et boissons
Pour Gaston Bachelard, la conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. L'homme est une créature du désir et non pas une créature du besoin. (156)
Sans doute de 1350 à 1550 l'Europe a-t-elle connu une période de vie individuelle heureuse. Après la catastrophe de la peste noire les conditions de vie forcément été bonnes pour qui travaillait. Contrairement à l'idée reçue jamais les salaires réels m'ont été aussi hauts qu'alors. Par exemple dans le Languedoc peu peuplé de 1520, les hommes mangent du pain blanc signe d'un niveau de vie élevé.
Mais le luxe de la table en Europe n'aura concerné ou plus que quelques privilégiés entre le 15e et le 16e. Par exemple l'idée d'une salle réservée au repas ne devient courante en France qu'avec le 16e siècle et seulement chez les riches. Auparavant le seigneur mangeait dans sa cuisine. De la même façon des manières de table civilisées ne sont pas encore répondues dans toutes les couches de la société vers 1600 (cf Norbert Élias).
Dans l'ensemble des nourritures, le sel est un aliment sacré, essentiel et irremplaçable. Les œufs font partie de l'ordinaire des Européens. Le poivre qui occupait encore vers 1650 le premier poste du trafic à Amsterdam, arrive désormais en quatrième position vers 1780, après les textiles, les épices fines, le thé et le café. Est-ce là le signe de la fin d'une consommation de luxe ? Parallèlement le sucre progresse, mais avec une extrême lenteur.
Les boissons ne sont pas seulement des aliments, elle joue aussi le rôle de dopants, d'évasion : l'alcoolisme sur cette période n'a cessé de grandir. Puis se sont ajoutés le thé, le café, ainsi que le tabac. Une des grandes articulations de la vie économique de l'Europe va de l'embouchure de la Loire jusqu'à la Crimée : au sud de cette ligne c'est l'Europe vinicole. L'ivrognerie grandit partout, ainsi à Valladolid la consommation au milieu du siècle atteint 100 l par personne.
Chapitre 4 : Le superflu et l'ordinaire : l'habitat, le vêtement et la mode
Dans le monde il y a deux comportements pour la vie de tous les jours : position assise et position accroupie, celle-ci omniprésente sauf en Occident. (252)
Si l'homme doit se loger s'habiller, se nourrir il ne le fait pas forcément dans des formes ordinaires. Nous ne sommes pas là dans le seul domaine des choses, mais bien dans celui des choses et des mots, C'est-à-dire de la symbolique. « Si le luxe n'est pas un bon moyen de soutenir, ou de promouvoir une économie, c'est un moyen de tenir, de fasciner une société. Enfin jouent les civilisations, étranges compagnies de biens, de symboles, d'illusions, de fantasmes, de schémas intellectuels… Bref, jusqu'au plus profond de la vie matérielle s'établit un ordre compliqué à plaisir, où interviennent des sous-entendus, les pentes, les pressions inconscientes des économies, des sociétés, des civilisations. » (290)
Chapitre 5 : La diffusion des techniques : source d'énergie et métallurgie
Selon Marcel Mauss, la technique est un acte traditionnel efficace, en somme un acte qui implique le travail de l'homme sur l'homme, un dressage entrepris, perpétué depuis le début des temps. « La technique est tantôt ce possible que les hommes pour des raisons surtout économiques et sociales, psychologiques aussi, ne sont pas capables d'atteindre et d'utiliser à plein ; tantôt ce plafond contre lequel butent matériellement, techniquement leurs efforts. » (293) Mais la rupture technique peut devenir le départ d'une vive accélération.
Le
premier problème clé est celui des sources d'énergie :
énergie humaine, animale, hydraulique, éolienne, la voile, le bois,
le charbon. « Avec les 11e, 12e et 13e siècle, l'Occident
connaît sa première révolution mécanique. Entendons par là
l'ensemble de transformations qu'a impliqué la multiplication des
moulins à eau et à vent. » (308) Le premier est plus ancien
et a une importance supérieure. Il est une sorte de mesure standard
de l'équipement énergétique de l'Europe préindustrielle. Par
exemple en Galicie, à la fin du 18e, les statistiques donnent 5243
moulins à eau contre 12 à vent pour 2 millions d'habitants. Il
suffit d'être attentif aux innombrables petites roues, visibles dans
tant de tableaux, dessins, de plan de villes pour comprendre combien
elles étaient généralisées. Il faudrait en comptabiliser entre
500 et 600 000 en Europe
à la veille de la révolution
industrielle.
Les civilisations d'avant le 18e sont des civilisations du bois et du charbon de bois, comme celles du 19e seront celle du charbon de terre.
On peut classer sans risque d'erreur selon leur importance décroissante des sources d'énergie : en tête la traction animale, 14 millions de chevaux, 24 millions de bœufs, chaque bête représentant un quart de cheval-vapeur, soit en gros 10 millions de HP (horse-power) ; le bois équivalent à 3–5 millions de HP ; les roues hydrauliques entre 1,5 et 3 millions de HP ; les hommes eux-mêmes (50 millions de travailleurs) représentants 900 000 HP ; enfin la voile, 230 000 HP.
Il y a une croissance à partir de 1730–1740, une sorte de pré-révolution industrielle.
Dans cette économie le fer est un parent pauvre.
Chapitre 6 : Révolutions et retards techniques
Trois grandes révolutions techniques : l'artillerie, l'imprimerie, la navigation hauturière.
L'échange qui est l'outil de toute société économique en progrès s'est trouvé gêné « par la limite qu'imposait le transport : sa lenteur, son faible débit, son irrégularité et finalement son prix de revient. Tout bute contre ces impossibilités. » (376) Napoléon se déplace à la lenteur même de Jules César. (Paul Valéry)
Chapitre 7 : La monnaie
Émergent des prêteurs d'argent (le prêteur sur gage, le propriétaire, le gabelou, etc.) Qui n'éveillent pas les sympathies : « dans les musées, les visages des manieurs d'argent nous regardent ; plus d'une fois le peintre a traduit la peine et le mépris de l'homme ordinaire. » (385) ==> méfiance populaire constante a l'égard de la monnaie elle-même. Mais cela ne change rien au mouvement historique lui-même.
« Le système monétaire, en Europe et hors d'Europe, souffre de deux mots sans remède : d'une part, il y a les fuites de métaux précieux vers l'extérieur ; d'autre part, ces métaux s'immobilisent du fait de l'épargne et d'une thésaurisation attentive ; résultat le moteur perd sans fin une partie de son combustible. » (406) Les métaux précieux ne cessent de sortir des circuits d'Occident en direction des Indes et de la Chine : pour payer la soie, le poivre, les épices, les drogues, les perles d'Extrême-Orient. La balance de l'Europe restera de ce fait déficitaire dans cette direction essentielle jusque dans les années 1820.
Mais ces problèmes monétaires n'affectent pas la majeure partie des hommes : vérité paysanne de partout, presque de toujours.
Chapitre 8 : Les villes
Quel que soit le lieu une ville implique toujours un certain nombre de réalités. Pas de ville sans division obligée du travail, de marché, de pouvoir à la fois protecteur et coercitif. Et vice versa, c'est la ville qui autorise ces développements par exemple l'ouverture sur le monde et l'échange entre villes.
Le degré d'urbanisation, c'est-à-dire le pourcentage de citadins est très variable selon les pays : autour de 16 % pour la France, 10 % pour la Grande-Bretagne, 2 à 3 % pour la Russie, mais 50 % pour la Hollande.
La ville c'est une force d'attraction : ses libertés réelles ou apparentes, ses salaires. Mais aussi parce que les campagnes rejettent ses hommes. « l'association courante, solide, c'est une région pauvre des migrants et une vie active » (431) : le Frioul vis-à-vis de Venise, les Kabylies vis-à-vis d’Alger, la Corse et Marseille, etc.
« Recrutement forcé, ininterrompu. Biologiquement, avant le 19e, la ville ne connaît guère d'excédent de ses naissances sur ses décès. Chez elle il y a surmortalité. » (431) Vers 1780, sur une trentaine de milliers de naissances Paris compte 7 à 8 000 enfants abandonnés.
Dans l'architecture des villes, celles-ci n'existent pas sans petites villes à proximité. Florence et Pise, Gênes et Savone, etc. Pour tisser et teindre les étoffes, pour organiser les roulages, pour rouler sur la mer, etc.
Il existe une originalité des villes d'Occident. Pourquoi les autres villes du monde ont-elles pas connu ces destins relativement libres ? Quel a été, pour elles, le ou les empêcheurs de danser en rond ? Pourquoi le destin des villes occidentales est-il sous le signe du changement ?
En simplifiant on peut dire :
L'Occident a perdu son armature urbaine avec la fin de l'empire romain.
La renaissance urbaine à partir du 11e se superpose à une montée de sève rurale, La multiplication des champs, des vignobles, des vergers.
Parallèlement à cela une économie monétaire en extension.
Autour de civils privilégiés, bientôt plus d'États. C'est le cas de l'Italie et de l'Allemagne avec les effondrements politiques du 13 siècle. Certaines villes deviennent des univers autonomes, des Etats-villes, bardé de privilèges.
En simplifiant l'occident a connu au cours de ses expériences 3 types essentielles de villes : « les villes ouvertes, c'est-à-dire pas distinguées de leur plat pays et même confondues avec lui ; les villes fermées sur elles-mêmes, closes au sens le plus strict et dont les murailles délimitent plus encore l’être que le domaine ; enfin les villes tenues en tutelle, en entendant par-là toute la gamme connue des sujétions à l'égard du prince et de l’État. » (453)
Seul l'Occident aura franchement basculé vers ses villes. Elles l'ont poussé en avant.
Cette poussée tardive serait impensable sans le progrès réguliers des États : ils ont rejoint le galop des villes. Une compétition s'engage entre elles notamment entre les plus grandes, les capitales. A qui les premiers trottoirs, les premiers réverbères, les premières pompes à vapeur, les premiers systèmes cohérents de réduction et de distribution d'eau potable, les premières numérotation des maisons ? Toutes choses que connaissent Londres et Paris avait de la révolution. (463)
Que conclure ? « Que Londres, à côté de Paris, est un bon exemple de ce que pouvait être une capitale d'ancien régime. Un luxe que d'autres doivent solder, un assemblage de quelques élus, de nombreux serviteurs et de misérables, tous liés cependant par un certain sort collectif de la grande agglomération. Sort commun ? Par exemple, l'effroyable saleté des rues, leur puanteur familière aussi bien au seigneur qu'au populaire. Sans doute est-ce la masse de ce dernier qui les crée mais elle rejaillit sur tous. Il est probable que jusqu'en plein 18e siècle, bien des campagnes étaient relativement moins sales que les grandes villes, qu'il est loisible d'imaginer la cité médiévale plus agréable à habiter et plus propre qu'elles. » (490)
Pour conclure
« Alors une civilisation qu'est-ce, sinon la mise en place ancienne d'une certaine humanité dans un certain espace ? C'est une catégorie de l'histoire, un classement nécessaire. L'humanité ne tend à devenir une que depuis le 15e siècle finissant. Jusque-là elle a été partagée entre des planètes différentes. Chacune abritant une civilisation ou une culture particulière. »
« Longue durée et civilisation, ces ordres préférentiels appellent à côté d'eux le classement supplémentaire inhérent aux sociétés, omniprésentes elles aussi. Tout est ordre social, ce qui pour un historien ou un sociologue, est après tout une réflexion digne de La Palisse ou de monsieur Jourdain. » « Mais plus encore que de société (le mot malgré tout est bien vague) c'est de socio-économies qu'il faudrait parler. Marx a raison : qui possède les moyens de production, la terre, les bateaux, les métiers, les matières premières, les produits finis et non moins les positions dominantes ? Il reste évident cependant que ces deux coordonnées société et économie ne suffisent pas à elle seules ; l'État multiforme, cause et conséquence tout à la fois, impose sa présence, trouble les rapports, les infléchie, le voulant ou non, joue son rôle, souvent lourdement, dans ces architectures qu'on peut regrouper à travers une sorte de typologie des divers socio-économie du monde, celles-ci à esclaves, celles-là à serfs et à seigneurs, celles-là à hommes d'affaires et pré-capitalistes. » (495)
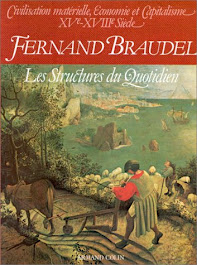



Commentaires
Enregistrer un commentaire