Histoire d'internet
Sébastien Broca, Pris dans la toile. De l'utopie d'Internet au capitalisme numérique, Seuil, 2025, 280 p.
Introduction
Les Big Tech ont donné l'illusion un temps que le numérique était un instrument de libération, mais on s'est aperçu qu'on rejouait là l'éternelle histoire de l'intégration de la critique par le capitalisme. Car réaliser des profits demeure le but et le moteur de ces entreprises et la logique de l'accumulation conduit à l'intensifier l'exploitation du travail et la nature. Ce qui est nouveau, c'est que les mouvements d'émancipation (partisan des logiciels libres, défenseurs des communs numériques) ont participé à la construction de ce monde de trois façons :
- Par la transformation idéologique en incarnant une Amérique libérale et progressiste, et en faisant oublier les liens historiques entre la Silicon Valley et le complexe militaro industriel : valoriser la liberté d'expression, le partage des connaissances, les énergies renouvelables dans « un mélange libéral-libertaire » (16).
- Par la transformation techno-économique en appuyant les modèles productifs sur un nouvel actif : les données. Et en utilisant les apports technologiques et la main-d'œuvre bon marché fournis par les projets militants ou non marchands (exemple de Wikipédia).
- Par la transformation du cadre juridique peu contraignant.
Première partie : expression
Différentes associations lancent aux États-Unis des batailles juridiques pour défendre l'utopie d'Internet, un espace « émancipé des pouvoirs situés ». Il en émerge un cadre réglementaire protecteur pour la liberté d'expression et favorable à l’essor des entreprises technologiques. Ces associations sont marquées par le rapprochement entre la contre-culture des années 1960 et le monde des hackers (cf Le parolier de Grateful Dead), c'est-à-dire sans considération pour le droit, ni pour la morale, dont les cibles principales sont la police, les militaires et les agences de renseignement. (24) Dans les balbutiements d'Internet, après qu'on a demandé des comptes aux entreprises mettant en ligne des messages condamnables, l'enjeu est de ne pas être considéré par les tribunaux comme l'éditeur des discours diffusés et donc comme juridiquement responsables de ceux-ci, la loi arbitre un peu en leur faveur puisque leurs actions de modération ne remettent pas en cause leur irresponsabilité sur les propos tenus en ligne. Ils entendent déléguer à des entreprises privées la police d'Internet, sans restreindre l'expression des internautes. « un exercice d'équilibrisme. » (29) En France est introduite en 2000 la notion d'intermédiaire technique afin de désigner les hébergeurs qui ne sont pas tenus comptables des propos tenus. Une nouvelle notion voit le jour, « la neutralité du net. » (35) Par ailleurs, le conseil constitutionnel censure une première version de la loi Hadopi votée pour lutter contre le téléchargement illégal. Le conseil souligne que nul ne peut être privé d'Internet sans une décision de justice ; il garantit ainsi que la liberté d'expression. « Ce qui émerge dans les années 1990 est ainsi un mouvement global de défense des libertés numériques, et non seulement des libertés dans l'environnement numérique. » (40)
Aux États-Unis, cette liberté est un élément essentiel de la culture, politique avec le premier amendement : « il interdit à l'État de censurer ou de porter atteinte à un grand nombre de discours afin de préserver les conditions nécessaires à l'autonomie individuelle, la recherche de la vérité et l'auto-gouvernement démocratique. » (43) La question qui se pose alors est de savoir quels sont les discours qui doivent être considérés comme des actes expressifs bénéficiant de cette garantie constitutionnelle : diffuser un système de chiffrement, est-il un enjeu de sécurité nationale ? Le code est-il un discours ? Le hacker qui a publié ces codes sera finalement acquitté. Il s'ensuit alors « une instrumentalisation néolibérale du premier abonnement » (47) : ni Facebook, ni Google, n’endossent la responsabilité des contenus diffusés sur leur plateforme et affirment aussi que la liberté de l'expression leur interdit de réglementer la manière dont elles organisent algorithmiquement les discours tiers, en vertu de l'idée que le code est un discours.
« Ces règles reflètent avant tout les stratégies commerciales des entreprises et l'image qu'elles souhaitent renvoyer aux annonceurs. » (53) Et ainsi, les démocraties libérales délèguent leur pouvoir aux grandes plateformes de régenter le net qui donc est organisé « indépendamment du cadre posé par le droit national et international » (54) : « Le contrôle sur l'expression publique connaît ainsi une forme d'industrialisation dans un cadre capitaliste. » (54) Le pouvoir des plateformes s'exerce donc selon trois modalités :
- Mettre en forme les prises de parole comme processus de normalisation de l'expression, cherchant à aligner celle-ci, avec « les cadres techniques, les intérêts économiques et les partis de idéologiques » qu'elles ont.
- Contrôler la diffusion des discours grâce à l'algorithme, l'enjeu étant non de savoir qui peut s'exprimer, mais qui sera entendu et par qui et dans quelle mesure.
- Modérer à la fois par les algorithmes et les humains, la machine prenant progressivement plus de place.
L'essentiel pour les entreprises étant de fidéliser les utilisateurs, de maximiser, le temps qu'ils passent en ligne, d'augmenter le volume de leurs interactions et de rendre exploitables celles-ci du point de vue commercial. Ces préoccupations économiques les poussent à promouvoir des discours clivants tout en se faisant les chantres de la liberté d'expression.
Au début de l'Internet, on parle encore de nétiquette, c'est-à-dire une forme d'autorégulation selon la conception libérale classique où le débat contradictoire se régule spontanément dès lors qu'il est libre. Mais cet optimisme a été démenti par l'explosion des fake News.
La défense de la liberté d'expression aux États-Unis a changé de camp. D'abord associée à la gauche dans les années 1980, les entreprises transforment le premier amendement en une arme anti-régulation et les intellectuels conservateurs fustigent le politiquement correct des élites progressistes, Bush accusant la gauche féministe et anti raciste d'attenter à la liberté d'expression, laquelle devient un leitmotiv pour la droite et l'extrême droite avec l'élection de Donald Trump. Comme le résume Zuckerberg en 2020 : « les démocrates nous accusent de ne pas modérer assez, les républicains de trop modérer. » Mais la critique du pouvoir des plateformes entraîne la création de réseaux sociaux alternatifs (GAB, Parler). Puis l'attaque du Capitole entraîne une grande tension entre les plateformes et le camp de Trump. La Cour Suprême énonce alors en 2024 que le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans les choix de modération des plateformes. Celle-ci, d'ailleurs diminue avec le rachat de Twitter, par Elon Musk, qu'il met au service de ses obsessions : la lutte contre l'immigration, le poids excessif des réglementations et de l'État fédéral, la haine du wokisme, la défense de la liberté d'expression. Le cadre réglementaire autorise donc le pouvoir privé sur l'expression en ligne (70). L'utopie d'Internet, comme espace public pluraliste est battue en brèche et le débat démocratique peut donc souffrir d'un manque d'accord minimal sur les faits. Et les dirigeants de ces plateformes finissent par faire allégeance à Trump après sa réélection. Au bout du compte « ces canaux sont aujourd'hui utilisés comme des armes contre les locuteurs défavorisés. » (75)
Deuxième partie : monopoles
Le renforcement du droit de propriété intellectuelle (DPI), marque un modèle fondé sur la privatisation de l'information et de la connaissance, quel que soit le secteur (culture, informatique, pharmacie, semence, etc.). Chaque produit est vendu à un prix supérieur à son coût de reproduction, grâce au monopole d'exploitation par la propriété intellectuelle. Il y a une rente de monopole. Ce qui tend à affaiblir les industries culturelles comme Hollywood, qui obtiennent en 1997 un durcissement de la répression du piratage. Microsoft aussi est déstabilisé par l’essor d'Internet avec l'apparition de Netscape. Il développe alors son propre navigateur Explorer qui supplante rapidement le premier car installé gratuitement avec Windows, ce qui est condamné dans un premier temps pour pratique anti concurrentielle, mais l'élection de Bush en 2000 solde la procédure et un accord à l'amiable est trouvé. Cependant, cette voie du logiciel libre incarnée par Netscape, et donc du code ouvert, est réinvestie par la Silicon Valley, qui y voit le moyen d’écrire de meilleurs logiciels, de comprimer les coûts en externalisant une partie du travail de programmation. D’autres turbulences voient le jour dans le secteur de la musique avec le téléchargement illégal (Napster). Des juristes réfléchissent alors à une réforme du copyright : diminuer la durée de protection des œuvres, légaliser leur partage dans un cadre non marchand.
Ces batailles recoupent donc une question transversale, celle des communs, à la fois les communs numériques et l'accès ouvert. A mesure que le nombre de contributeurs à Linux ou Wikipédia augmente, la question des règles auto-instituées se pose. Les communs numérique se construisent autour de trois éléments : des ressources partagées ; des règles encadrant leurs usages ; des communautés organisées pour en conduire le développement. (96) Ces luttes ont un écho en France, comme luttes anti capitalistes et moyens de transformation sociale après la faillite du communisme étatiste.
Mais les grandes entreprises intègrent les communs à leur régime d'accumulation, notamment après l'éclatement de la bulle Internet en 2000, en ne maîtrisant plus l'accès à des biens informationnels protégés par des DPI, mais en valorisant les activités de leurs usagers : « il s'agit d'extraire de la valeur à partir des contenus et des données que les internautes produisent, volontairement ou non. » (101) Ce nouveau modèle met en relation les utilisateurs et d'autres acteurs comme les annonceurs : c'est l'émergence du marché biface érodant ainsi la forme traditionnelle de la marchandise comme unité de valeur d'usage et valeur d'échange. La logique de visibilité prévaut et contribue à asseoir une entreprise du secteur déjà dominante. Les actifs que sont les données et les algorithmes sont difficiles à protéger par le droit des brevets et du copyright. Toutes les grandes entreprises technologiques doivent une part de leurs succès aux logiciels libres : alors qu'ils étaient perçus comme des alternatives à celles-ci, « ils en sont devenus les adjuvants. » (107)
Pour réduire ces monopoles, des juristes attachés au libéralisme demandent à ce qu'il y ait des politiques antitrust garantissant une véritable concurrence, ou bien que ces entreprises aient des obligations de service public.
Le développement du big Tech connaît un nouvel essor avec l'intelligence artificielle, car ces entreprises possèdent seules les ressources et les capacités d'investissement nécessaires. L’IA repose la question du copyright et est une menace pour les professions créatives. C'est un système qui n'est ni un programme ni un ensemble de données et donc les critères ayant servi à définir les logiciels open source sont inapplicables. Les big Tech argumentent qu'on ne peut faire supporter aux développeurs des responsabilités sur les utilisations futures de ces outils, en invoquant encore une fois la libre utilisation du code.
Troisième partie : données
Des questions récurrentes se posent aujourd'hui autour de la vie privée, mais qu’entendre par là ? Au cours du temps, il y a eu trois usages de cette notion :
- le respect de l'intimité : dimension spatiale, se soustraire au regard d'autrui ;
- la protection contre l'interférence de l’État et d'autrui : sphère de l'autonomie individuelle, mener son existence librement ;
- le contrôle sur les informations qui nous concernent : préoccupation apparue avec l'informatique.
Avec cette dernière dimension, les données personnelles comprennent tout ce qui est relatif à la personne et donc invitent à considérer l'individu comme pouvant déterminer ce qu'il souhaite communiquer à autrui. Cela repose donc sur l'individu : « la vie privée n'est plus une sphère personnelle protégée, c'est une capacité à maîtriser les flux de données et d'informations. » (146)
Car avec l'invention du cookie (1994), Internet devient un nouveau gisement de données que des universitaires marxistes considèrent comme une nouvelle marchandise. Celles-ci restent sous le contrôle des plateformes, car elles favorisent « à la fois l'innovation technologique, l'amélioration des services, l'anticipation de certaines tendances et la captation de revenus publicitaires. » (154) Leur captation représente un nouveau danger pour l'usager. E. Snowden en révèle l'amplitude, puisque la NSA peut accéder aux serveurs des grandes entreprises où sont stockées des données personnelles d'internautes résidant hors des États-Unis. La collaboration des firmes avec les services de renseignement est démontrée.
La protection de la vie privée doit donc être technique plutôt que juridique, même si en Europe de nombreuses organisations demandent une protection de la personne (alors qu'aux États-Unis la protection des données personnelles relève du droit de la consommation). Et les dirigeants des plateformes minimisent la vie privée, comme quelque chose de dépassé historiquement. Au bout du compte, « il existe un décalage manifeste entre la théorie (chacun contrôle l'utilisation de ses données) et la pratique (personne ne contrôle grand-chose). (171) Car sur Internet, il existe deux types de données : celles intentionnelles (blog, mail, photo, like, etc.) ; et celle liées aux tâches habituelles et nécessaires de la vie sociale, involontairement disséminées au gré d'activités. Les premières sont sinon contrôlées en tout cas conscientes alors que les secondes sont totalement ignorées et donc l'incitation à protéger cette dimension de la vie privée est faible.
À partir de 2015, la critique des big Tech est portée par d'anciens salariés qui dénoncent des pratiques vouées à la captation de l'attention et à la manipulation des utilisateurs. C'est ce que certains ont appelé le capitalisme de surveillance (Zuboff) qui consiste à observer les comportements des consommateurs, afin de prédire leurs actions futures et même de les modeler, un capitalisme, d'autant plus dangereux qu'il est presque perceptible. Sans doute là, ce diagnostic est-il exagéré et renforce les représentations de la toute-puissance des entreprises du numérique. Cette toute-puissance est d'ailleurs mise en échec, puisque par exemple l’intelligence artificielle peut-être dévoyée quand on sait que elle fonctionne d'abord en fonction des hommes blancs. Les critiques internes au système sont-elles mêmes limitées car elles sont produites par des gens dont les dispositions profondes ont été modelées au sein de ses entreprises. C'est pourquoi ils ne voient pas certains travers, lesquels ne peuvent être révélés que par des gens extérieurs comme T Gebru, femme afro-américaine, plus à même de « questionner les fantasmes de puissance technologique, dont les composantes viriliste, classiste et raciste ont été mises en évidence. » (195)
Quatrième partie : ressources
Si on revient aux fondements historiques, l'ordinateur apparaît comme un instrument de libération individuelle et comme un outil écologique qui naît dans un mode de vie associant vie communautaire et objets high-tech. Dans ce discours, la matérialité du numérique semble le plus souvent absente et d'ailleurs des discours sur la fin du travail émergent alors. Les contreparties sociales et environnementales de l'émergence du numérique sont occultées. Néanmoins, des discours néo-luddites voient le jour, ciblant l'informatique comme une technologie polluante, dangereuse pour la vie privée, déqualifiant les emplois et renforçant les bureaucraties. D’autres critiques venant de l'école de Francfort, mobilisant Orwell, Ellul, Debord ou Castoriadis se font jour. Mais elles sont souvent détachées des organisations de travailleurs et plus largement de la conscience individuelle et collective.
Pourtant, les conséquences environnementales et sociale sont réelles, puisque ces nouvelles technologies entraînent un nouvel extractivisme.
D'autre part, une réflexion sur la production de la valeur est proposée, puisque le travail productif déborde les lieux où il était traditionnellement confiné (l'usine, le bureau), des temps où il était circonscrit (les horaires de travail) et la forme juridique qui l'encadrait (le salariat). Désormais, il y a une production de plus-value en dehors des activités liées à l'emploi, et un marxisme hybride tente donc de concilier quantification de l'exploitation et extension de la notion de travail productif. Ces travaux montrent combien il est difficile de déterminer d'où provient la valeur et de la mesurer au sein de l'économie numérique.



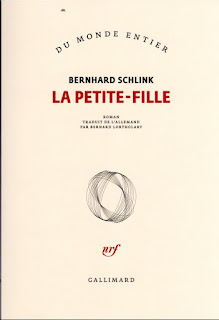
Commentaires
Enregistrer un commentaire