George Sand : Mauprat
George Sand, Mauprat, epub 2004 (1837), 305 p.
Cette histoire se présente presque comme un conte . D’emblée on fait connaissance avec la branche exécrable de la famille Mauprat, avec des hommes méchants, qui vivent de vices, de violences et de mauvais coups. Le narrateur en fait l’amère expérience, puisque orphelin il est pris en charge par son grand-père peu amène :
« Ah ! Çà ! Mon pupille, venez chez nous, et tâchez de ne pas pleurer longtemps ; car je n’ai pas beaucoup de patience avec les marmots.
En effet, au bout de quelques instants, il m’appliqua de si vigoureux coups de cravache, que je cessai de pleurer, et que, me rentrant en moi-même comme une tortue sous son écaille, je fis le voyage sans oser respirer. » (10)
Toute cette première partie est très réussie par la description détaillée de tous les mœurs détestables de cette partie malfaisante de la famille auxquels Bernard, le jeune garçon, ne succombe pas complètement puisqu’en particulier il refuse l’injonction de ses aînés de violer Edmée sa cousine qu’il fait échapper sous la promesse (ou le chantage) de l’épouser. C’est le sens de cette discussion initiale qui va faire l’objet du colloque entre ces deux jeunes gens pendant presque toute la durée de l’histoire. Avec des moments plus faibles (le départ en Amérique), mais des personnages denses (tel Patience cet homme « rousseauiste » de la nature), et surtout des dialogues imparables qui font la part belle au romantisme de l’auteur comme dans cette déclaration d’Edmée : « Tous ceux qui ont été à la Roche-Mauprat n’en sont pas revenus. Moi, j’ai été, non y subir la mort, mais me fiancer avec elle. Eh bien ! j’irai jusqu’au jour de mes noces, et, si Bernard m’est trop odieux, je me tuerai après le bal. » (120). Edmée attend donc que Bernard se transforme de l’intérieur pour être digne d’elle, et tout l’enjeu se situe là : en est-il capable ? L’abbé, au centre de ce dispositif de confessions multiples en doute, et Edmée aussi : « Pour s’instruire ? Jamais il n’y consentira ; et quand il s’y prêterait, il ne le pourrait pas plus que Patience. Quand le corps est fait à la vie animale, l’esprit ne peut plus se plier aux règles de l’intelligence. » (121) Cette recherche du bon mot peut tendre à prendre le pas sur l’histoire elle-même dont on se doute qu’elle se terminera bien même malgré les nombreuses vicissitudes auxquelles Bernard est confronté dont celle de son procès pour meurtre sur sa dulcinée ! C’est en cela que c’est un conte, une histoire qui se finit par le mariage et la nombreuse engeance, mais un conte au style flamboyant et aux trouvailles littéraires comme ce moment où Bernard est en soins intensifs, et quand il reprend des forces grâce à l’action d’Edmée, celle-ci « rentra dans les bornes de l’amitié tranquille et prudente. Jamais personne ne recouvra la santé avec moins de plaisir que moi. » (130) Mais au final, l’amour triomphe après que les protagonistes se soient débarrassés de leurs réticences et préjugés respectifs, car « la beauté est comme un temple dont les profanes ne voient que les richesses extérieures. » (182)
En définitive, c’est intéressant cette histoire écrite par une femme mais dont le narrateur est un homme et où la femme tient sinon le rôle principal en tout cas celui qui décide.



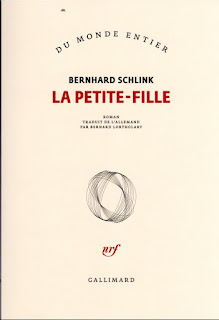
Commentaires
Enregistrer un commentaire