Les jeunes dans les cités : ethnographie des usages de l'espace
Mickaël Chelal, Grandir en cité. La socialisation résidentielle de « jeunes de cité », Éditions Le Bord de l'eau, 2025, 240 p.
L'auteur s'attache à saisir la vie dans les cités au moyen d'une enquête ethnographique portant principalement sur les rapports entre les jeunes. Il met ainsi à jour les relations entre garçons et filles, entre « petits » et « grands », enfants et adultes.
Ainsi quand les jeunes jouent ensemble, ils sont sous le contrôle social des adultes au sens large, puisque ce ne sont pas forcément les parents qui peuvent leur dire telles ou telles choses comme par exemple de reprendre un manteau qui a été oublié sur un banc.
Les utilisateurs peuvent s'approprier l'espace en dehors des aires de jeux prévues à cet effet. Si les filles semblent avoir les mêmes libertés horaires que les garçons du même âge, en revanche l'espace qu'elles peuvent utiliser est plus restreint. De plus elle se voient souvent attribuer des responsabilités comme surveiller leurs frères et sœurs, lesquelles doivent rester dans le square d'habitation. Par ailleurs, les filles jouent plus souvent à des jeux perçus comme masculins que l'inverse.
Un des problèmes liés à ce type d'habitat vient des nuisances sonores ressenties qui peuvent nuire à la vie sociale, et qui du coup ont aussi des conséquences sur la vie des jeunes amenés à être plus souvent en dehors, phénomène accentué par des logements exigus.
Grandir dans les cités suppose un apprentissage des codes sociaux en particulier la reconnaissance d'une hiérarchie entre les grands et les petits. Connaître des grands confère une sorte de prestige, et du coup être reconnu par eux devient « un enjeu pour les enfants afin de s'inscrire dans la vie de la cité et y connaître sa place. » (58)
La vie sociale des enfants est marquée par la dimension collective : les jeux mobilisent le plus souvent plusieurs individus, et toutes ces activités ont des conséquences sur l'apprentissage de certaines valeurs de solidarité et d'égalitarisme comme par exemple partager ses gâteaux.
Si la hiérarchisation des groupes enfantins est moindre que chez les plus âgés, elle existe néanmoins, par exemple par rapport au niveau de football, ou à travers la force, l'aptitude à la bagarre, la connaissance de jeux multiples, etc.
Toute la vie sociale se fait dans un univers où les conditions d'existence sont difficiles et l'accès à l'emploi plus limité pour les jeunes issus de l’immigration extra européenne. Ces difficultés ont des conséquences sur la mise en couple et la décohabitation plus tardive que pour les jeunes issus de souches européennes.
Les jeunes qui découvrent la vie sociale, découvrent aussi une organisation marquée par un ordre entre petits et grand, ordre sans cesse rappelé, ordre marqué aussi par la prégnance des valeurs masculines dans ces espaces publics. Cette hiérarchie d’âge s'entend dans le vocabulaire utilisé comme « petit », « petit mort », ou « microbe », qui remplacent souvent le prénom et qui insistent sur l'infériorité du statut, puisque les grands occupent toujours une position dominante.
Aussi, les valeurs principales de ce rapport de domination sont traduites par le respect et l'honneur qui interviennent souvent à travers la question des réputations. D'abord le respect dû aux parents lequel indique des relations hiérarchiques plus soutenues entre parents et enfants que dans d'autres milieux sociaux caractérisés quant à eux par la proximité. Ce respect est notamment visible à travers la salutation, et donc la poignée de main exigible vis-à-vis des plus âgés, mais aussi l'ordre dans lequel on a accompli les salutations, toujours les plus âgés avant les plus jeunes, y compris vis-à-vis des jeunes adultes qu'on se doit de regarder dans les yeux et qu'on doit saluer les mains propres. « Il n'est pas permis pour un petit de ne pas saluer un grand, alors que l'inverse est tout à fait possible. » (131) Le respect aussi est dû aux enseignants à la condition qu'il soit réciproque. Et le contexte de la classe peut pousser les élèves à l'insolence pour ne pas perdre la face.
L'insolence, ou la prise de risque, sont des moyens utilisés par les petits pour montrer leur existence sociale auprès des grands qui peuvent alors les intégrer dans leur groupe. En grandissant, les petits sont amenés à fréquenter les mêmes espaces que les plus grands comme le centre commercial, et changent ainsi de statut.
Un grand peut choisir de devenir le mentor d'un plus petit qui devient « son petit ». C'est surtout le cas pour les plus charismatiques ayant un rôle de régulateur de la vie sociale, mais aussi des passe-droits dont profitent alors les petits en question. Ces relations de protection et de bienveillance peuvent aussi se transformer en relation d'initiation à la délinquance. Dans tous les cas, les grands retirent certains bénéfices : la reconnaissance, l'affection, l'amitié.
L'appropriation de l'espace peut donner lieu aussi à des jeux plus ou moins violents de compétition. Mais aussi à des négociations avec les habitants pour pouvoir utiliser l'espace public à des fins privées (comme utiliser un barbecue). Il existe enfin un usage nocturne de l'espace dont sont habituellement privées les filles.



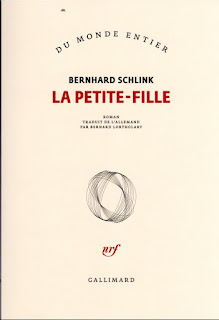
Commentaires
Enregistrer un commentaire