Parcours d'un sociologue
Victor Collard, Pierre Bourdieu. Genèse d’un sociologue, CNRS Éditions, 2024, 447 p.
L'auteur essaie de comprendre le cheminement de Bourdieu en particulier son rapport à la philosophie depuis son enfance jusqu'au premiers travaux de sociologue. Il relève que dans son milieu familial, on est assez distant de cette matière car ses parents n'ont pas fait d'études longues. Ce n'est qu’au lycée qu’il est confronté pour la première fois à ce discours. Il faut donc analyser la trajectoire exceptionnelle de Bourdieu, en mobilisant cinq types de grandes causes :
- le genre : si faire des études pour les filles issues des milieux paysans, leur permet d'échapper aux travaux des champs et peuvent favoriser une ascension sociale, les statistiques disent que dans les années 30, la proportion des bacheliers chez les garçons est deux fois plus élevée que chez les filles.
- La position sociale : sa famille n'est pas totalement dominée, son père a connu une petite ascension sociale et sa mère a reçu un héritage.
- La mobilisation familiale : elle est notamment visible dans le choix de l'enfant unique, il y a chez ses parents comme un regret d'école puisque eux-mêmes ont été privés de l'opportunité de faire des études.
- La promotion sociale des élèves des classes populaires par l'école avec pour Bourdieu, des individus (professeur, proviseur) qui repèrent ses capacités, car eux-mêmes ont connu une trajectoire homologue.
- Et enfin, le prix du concours général, qui constitue une cérémonie de consécration scolaire, marquant la réussite de jeunes élèves considérés comme les plus prometteurs de France dans chaque discipline. Bourdieu obtient un prix en 1947 en version latine. Ce sont les élèves des lycées de province qui sont les plus primés, indiquant ainsi une stratégie provinciale de promotion des élèves les plus brillants par l'investissement dans le concours général. Ce concours a servi de rampe de lancement à bien des destinées : Lavoisier, Robespierre, Desmoulins, Jaurès, Pompidou, Baudelaire, Bergson, Victor Hugo, Pasteur, etc.
Par la suite, en classe prépa, Bourdieu, s’adonne à la philosophie en faisant ce qu'il appelle « les choix de bon élève qui suit toujours la carrière, et qui choisit toujours ce qu'il y a de mieux » (cité p. 84), c'est-à-dire en étant stratégique par rapport aux études. Dans la manière, même dont les Khâgneux étudient, on peut observer « un rapport instrumental, pragmatique, voire étroitement calculateur à la culture et au travail intellectuel » (Bourdieu, la noblesse d'État, p. 117).
Ce bachotage peut être vivement critiqué par les jurys de l'École normale supérieure, comme le montre ce rapport de 1924 : « On se demande comment certains candidats ont pu réussir à passer leur baccalauréat assez décemment pour être poussés en première supérieure, comment ils ont pu, après plusieurs années de contact intime avec les plus grands génies classiques, conserver cette débilité de pensée, cette absence de logique, cette vulgarité de sentiments et d'expression. Certains paragraphes, s’ils avaient été écrits par des primaires, seraient cités triomphalement par les défenseurs exclusifs de la culture classique ; il est attristant de penser qu’ils sont l'œuvre de jeunes gens qui ont largement bénéficié de cette culture et qui aspirent à la noble tâche de la transmettre. (cité, page 116)
A l’ENS Bourdieu étudie la philosophie et entreprend la mémoire sur Leibniz. On a pu remarquer que ce sont les élèves les plus favorisés scolairement qui privilégient l'étude des auteurs canoniques (Kant, Spinoza, Hegel, Platon, Descartes, Aristote, etc.) auteurs les plus intimidants en raison de la masse de travaux existant à leurs propos. Mais le choix d'un auteur est avant tout un positionnement stratégique comme investissement en vue du concours de l'agrégation. L'étude de Leibniz suppose des compétences rares comme la connaissance du latin ou du calcul différentiel.
Bourdieu obtient l'agrégation en 1954 et est affecté dans un lycée de province à Moulins, dans lequel il se fera notamment remarquer par le discours de fin d'année en juin 1955, intitulé « l'éloge de l'ennui » (retranscrit page 189) dans lequel il se moque de l'exercice. Il commence à affirmer ses positions philosophiques, notamment en voulant se démarquer de l'entreprise de Sartre alors dominant dans le champ philosophique en France. Par la suite, il fait la sociologie du champ philosophique, en montrant que les philosophes du concept comme Bachelard, Piaget, Guéroult, Canguilhem ou Vuillemin ont tous comme point commun, de venir des classes populaires ou de la petite bourgeoisie et surtout de la province, à la différence des philosophes existentialistes. Comme il a été « fabriqué » par l'école, il est porté à reconnaître les représentants les plus académiques plutôt que les philosophes hors système. Mais s’il démarche quand Canguilhem pour devenir son directeur de thèse, c'est aussi en raison du parcours très singulier de celui-ci, puisque outre la thèse de philosophie, il possède une thèse de médecine. Avec lui, il travaille la physiologie, la médecine psychosomatique et donc la sociologie des émotions qu'il met en œuvre, montre que le corps est structuré très profondément avec des réactions physiologiques visibles et des réactions physiologiques invisibles comme la sécrétion d'adrénaline. Il relève des expressions du sens commun, comme « ça me fait mal au ventre », « ça me noue les tripes » qui montrent une correspondance et étroite entre le corps et l'esprit. (226)
C'est pourtant son départ en Algérie pour effectuer son service militaire au moment de la guerre, qui va réorienter le parcours intellectuel de Bourdieu et l'amener à l'ethnologie et à la sociologie. C'est là qu'il effectue un gros travail bibliographique sur l'Algérie et les civilisations en général, autour des sociologues américains et des phénomènes d'acculturation, qui l'obligent à brasser l'histoire économique, la sociologie, la psychologie, etc. Dans cette entreprise, il n'est pas isolé puisque sur la période 1945–1960, pas moins de la moitié des sociologues français, réalisent leurs recherches sur un terrain colonial. Il bénéficie aussi du travail de Lévi-Strauss qui opère une rupture fondamentale dans le champ ethnologique en le rebaptisant anthropologie, et qui de ce fait transforme le champ intellectuel en remisant la philosophie à un rang secondaire. Tous les gens qui dominent l'espace universitaire à la fin des années 60 et au début des années 70 sont des représentants des sciences de l'homme : Lévi-Strauss, Braudel, Dumézil, etc.
Comme il le reconnaît lui-même son passage à la sociologie a à voir avec sa trajectoire sociale, puisque les disciplines des sciences de l'homme lui permettent de se réconcilier avec ses expériences d'enfant. Il est porté à objectiver toutes les données de la vie sociale, faisant des statistiques sur tout, sur l'âge des voitures par exemple avec l'idée de mesurer leur ancienneté en fonction de la distance des habitants au bourg. « Tout était objet d'objectivation, mais cette objectivation, c'était l'objectivation du sujet de l'objectivation. Et c'est pour cela qu'il y avait cette espèce de fureur. (Citation page 332)
Le passage des individus d'une classe sociale à une autre s'accompagne fréquemment d'un effet d’hystérèse, concept qui désigne la perpétuation d'un phénomène, alors que sa cause a disparu.
Mais même après qu'il soit sorti du champ philosophique, Bourdieu, continue de citer les grands philosophes, sans doute afin d'y trouver un effet de légitimité, et rappeler aussi à certains égards d'où il vient. Mais son approche n'est pas celui d'un exégète : « si je me trompe, tant pis. Mon but n'est pas de dire la vérité sur Weber. Ce n'est pas mon travail. Je suis un chercheur. Je cherche des incitations à réfléchir et des instruments pour réfléchir. » (cité p. 393)
Quand un éditeur allemand, lui demanda en 1989, d'établir une liste des grands textes, théoriques et scientifiques du XXe siècle, il suggéra entre autres Bachelard, Canguilhem, Gombrich, Husserl, Merleau-Ponty, indiquant ainsi que dans le champ de la sociologie qu'il avait contribué à forger les racines philosophiques étaient importantes. Il en irait sans doute aujourd'hui autrement puisque la sociologie a gagné en autonomie.



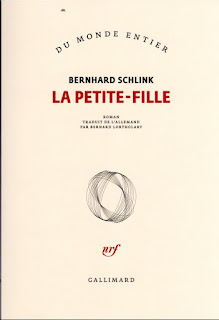
Commentaires
Enregistrer un commentaire