Comment sortir du capitalisme
Jean et Lucien Sève, Capitalexit ou catastrophe, La Dispute, 2018, 195 p. (octobre 2025)
Il s'agit d'un de s'interroger sur le devenir de nos sociétés capitalistes frappées par la catastrophe environnementale. Contrairement à une idée reçue Marx n'était pas un productiviste car il avait vu que le capitalisme « a pour sens de subordonner toute valeur d'usage à sa valeur d'échange », et donc que « la nature devient un pur objet pour l'homme, une pure affaire d'utilité. » (18) C'est d'autant plus vrai avec les politiques libérales et son laisser-faire généralisé avec le moins d’État possible et les 3 D : dénationalisation, déréglementation, désintermédiation bancaire, car les banques sont concurrencées par des fonds divers (fonds de pension, fonds d'investissement, fonds souverains, etc.) qui dominent aujourd'hui la finance mondiale et qui ne vont plus dans le sens d'une politique économique capitaliste où l'État jouait un grand rôle (De Gaulle ou la Chine d'aujourd'hui).
Le capitalisme pour faire court tient en quatre mots : marché, salaire, concurrence, taux de profit. Contrairement à ce que ces défenseurs affirment, le marché capitaliste ne fonctionne pas pour améliorer les choses : il existe plein de cas de figure où l'honnêteté marchande n'existe pas (Monsanto, Nestlé, Volkswagen, Servier, etc.). Il y a une dissymétrie énorme entre ces puissantes sociétés transnationales et la demande, incapable de faire contrepoids. Si la régulation des échanges par la valeur existe dans le sens d'une régulation quantitative (y compris par la pression sur les salaires et la productivité du travail), « ce critère régulateur laisse délibérément de côté la valeur d'usage » (38), et par exemple le côté pollueur du diesel. Et « les contrôles officiels sont du pipeau », quand on sait, par exemple que la commissaire européenne chargée de surveiller la concurrence était elle-même administratrice de plusieurs dizaines de grandes sociétés capitalistes. (43) Les institutions européennes sont donc complices du système capitaliste : la banque centrale prête à 1 % des capitaux aux banques privées qui vont les re-prêter à 4 % !
La politique elle-même a été convertie en un marché avec des équipes de politiciens qui élaborent pour diverses fractions de la classe dominante des offres politiques qu'elles vendent au corps électoral. (59) Or, si les grands nous paraissent comme tels, c'est parce que nous sommes à genoux (Élisée Loustalot).
L'histoire montre que ce sont les maillons faibles de la chaîne impérialiste, c'est-à-dire des pays en retard sur le développement capitaliste où les révolutions se sont produites. Aussi existe-t-il « ce paradoxe historique qu'en gros la révolution socialiste n'a guère eu lieu que là où elle ne pouvait gagner à terme. » (83) Aussi, la stratégie communiste révolutionnaire a eu pour effet deux errements catastrophiques : le programatisme qui ne tient pas compte de la réalité et le verticalisme qui pense changer la société par le haut, d'où un État, une bureaucratie et un parti hypertrophiés.
Aujourd'hui, pour changer les choses, il faut envisager « des réformes révolutionnaires » (93). Par exemple, dans le domaine de la consommation en particulier alimentaire, l'existence d'associations qui imposent à la chaîne de production l'agriculture bio. De même dans le domaine de la production, il existe tout un secteur coopératif ou le travailleur est copropriétaire de l'outil de travail. « Ce qui s’esquisse à petit bruit, n'est-ce pas une autre façon d'arriver au pouvoir, non par l'insurrection armée, mais par la conquête idéologique et pratique d'une hégémonie ? » (95) C'est donc un processus d'appropriation individuelle et collective qui ne se réduit pas à la propriété des choses, mais plutôt « à la croissance personnelle », c'est-à-dire l’accroissement de l'être : il faut donc convertir l'appropriation–propriété en une appropriation–maîtrise des choses. (101)
De ce point de vue, la transition écologique n'assure pas un changement de paradigme : postproductivisme n'est pas postcapitalisme puisque ça ne remet pas en cause la marchandisation de la force de travail, ça ne touche pas à l'aliénation générale des individus et ça ne remet pas en cause l'aliénation de la nature. La critique, Mélenchon hyène ne vient pas abolir la société de classe, mais seulement y instaurer une démocratie radicale. Des réformes révolutionnaires peuvent radicalement changer la société comme : l'idée d'un salaire à vie socialisé, avec salarisation de tous les jeunes dès la fin de leur scolarité obligatoire ; la sécurité emploi–formation ; l'extension de la gratuité (comme cela se produit déjà dans l'économie du numérique), etc.
« Comment peut alors se constituer l'organisation politique du capitalexit ? Par formation en chaîne de collectifs appropriatifs s'attachant chacun en toute responsabilité à rendre hégémonique une forme révolutionnaire précise. Ce qui prendra ainsi forme, ce sera une pluralité croissante de collectifs s’autogérant tout en formant tissu par leurs échanges horizontaux et entrecroisés. » (175)



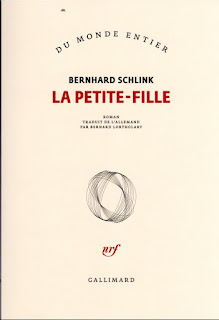
Commentaires
Enregistrer un commentaire