Regard historique sur l'inextricable situation du Proche-Orient
Benny Morris, Victimes. Histoire revisitée du conflit, arabo–sioniste, Éditions Complexe, 2003 (1999), 853 p.
I) La Palestine d'autrefois
L'affaire Dreyfus marqua un grand tournant dans la vie de nombreux juifs d'Europe centrale et occidentale tout comme les pogroms 2881–1882 pour les juifs d'Europe orientale : l'assimilation ne résoudrait pas le problème. Le sionisme apparaît donc un quart de siècle avant le nationalisme arabe, une longueur d'avance décisive en termes de conscience et d'organisation politique. (40)
II) Les débuts du conflit. Les Juifs et les Arabes en Palestine (1880–1914)
Une lente expropriation débute, avec les premiers colons juifs et l’appui de leurs alliés extérieurs. Naissent des kibboutzim (implantations collectives) et les mochavot (exploitant la main-d'œuvre locale à bon marché) dans une relation coloniale avec les autochtones : exploitation, dépendance mutuelle, mépris, racisme, haine, et peur (53). « Dès le début, les protagonistes se mirent des bâtons dans les roues : les autorités ottomanes bloquèrent l'immigration et entravèrent la construction des implantations, tandis que les juifs leur mentaient, les corrompaient, échappaient et violaient leurs lois et restrictions. Des siècles d'oppression et de discrimination en diaspora, avaient fait naître de telles pratiques parmi les Juifs – pratiques nécessaires pour survivre dans un environnement hostile et qui constituaient un des principaux éléments du bagage que les Juifs emportaient avec eux en Palestine. » (54)
Mais les nouveaux migrants cherchaient à se transformer en fermiers robustes et pragmatiques, loin des représentations et pratiques habituelles (revendeurs, colporteurs, usuriers, intellectuels délicats et sans racines). Les Arabes de Palestine se trouvèrent confrontés à de nouveaux juifs, « en furent très surpris, et parfois même intimidés ». (59)
Mais bien que minoritaires les colons commencèrent à se comporter en grands seigneurs et maîtres en utilisant le fouet à la moindre provocation. Ce qui constituait pour les Arabes une source intarissable d'animosité. « Quelques observateurs juifs interprétaient ce phénomène comme un moyen pour les « nouveaux Juifs » de se dédommager des siècles de coups portés par les gentils. » (62)
III) La première guerre mondiale. La déclaration Balfour et le mandat britannique
IV) La rébellion arabe
Après 1929, date de son ouverture au groupement sioniste de la diaspora, l'agence juive, disposa de fonds nettement plus importants à consacrer à l'immigration. En 1939, la Palestine comptait 1 070 000 Arabes dont 950 000 musulmans et 460 000 Juifs. Les Arabes représentaient donc 82 % de la population en 1931 et leur proportion tomba en dessous des 70 % en 1939. Les Arabes craignirent un peu plus chaque jour de voir les Juifs constituer la majorité. Ben Gourion déclara d'ailleurs : « eux et nous poursuivons le même but. Chacun de nous veut la Palestine. Si j'étais arabe, je me révolterais contre une immigration susceptible d'entraîner un jour la domination juive du pays. » (140)
« Souvent, la radicalisation des Arabes se teinta de religiosité : de plus en plus, les pommes de discorde avec les sionistes étaient des valeurs et symboles religieux, ou y étaient identifiées. » (142)
En 1929 éclatèrent des émeutes arabes. Plusieurs éléments participèrent à l'explosion de cette violence. L'incapacité de la Grande-Bretagne à arrêter la conquête mussolinienne et hitlérienne, montra sa faiblesse militaire et politique, « ce qui ne pouvait qu'inciter ses adversaires à la braver. » (146) La crise économique en Palestine, favorisa également le déclenchement de la révolte.
En 1936–39 a lieu une révolte. Pour la minimiser, les juifs et les Britanniques appelèrent ces violences des évènements et des troubles. Pourtant, « cet épisode de violence resterait le plus grave et le plus long que connaîtraient les Britanniques au Moyen-Orient, mais aussi le plus important de l'histoire palestinienne jusqu'à l'intifada contre les Israéliens 50 ans plus tard. (147) Ce mouvement rencontre d'abord l'assentiment des populations arabes. Il débute par une grève, mais les juifs remplacent les grévistes sur les postes, ce qui contribue à amener la communauté juive vers l'autarcie. Les violences arabes furent qualifiées de pogroms ce qui diabolisait les Arabes et les juifs s'employaient à distinguer les bons des mauvais arabes. Ben Gourion : « il s'agit d'un conflit fondamental. D'un côté, comme de l'autre, on recherche la même chose : chacun de nous veut la Palestine. (…) Par le fait, même de notre présence et de nos progrès sur cette terre, nous avons nourri le mouvement arabe. » (cité page 155.) Il ajoutait : un État juif dans une partie de la Palestine n'est pas une fin mais un commencement. Le territoire n'a pas seulement d'importance en soi. C'est aussi un gain de pouvoir qui nous permettra ensuite de mettre plus facilement la main sur la totalité de la Palestine. L'établissement d'un petit État fera effet de levier et nous aidera grandement dans nos efforts historiques pour récupérer la totalité du pays. » (157) Les Arabes s’opposèrent à cette prise de possession d'un bien considéré comme légitime, le sol sacré musulman.
Une commission (Peel) préconisait de procéder à un échange de population, afin d'éviter que l'État juif compte presque autant d'Arabes que de juifs. Cette idée de transfert, les pères du sionisme moderne en avaient déjà ébauché le projet. C'était un des courants dominants de l'idéologie sioniste depuis la création du mouvement. La création d'un État juif avérerait impossible sans une majorité juive, laquelle ne pouvait se constituer que par une immigration massive. (158) Pour les dirigeants sionistes, la nécessité d'obtenir un pays largement inhabité, capable d'assimiler de futurs immigrants l'emportait moralement sur les droits des indigènes arabes. Ils persuadèrent la commission Peel d'adopter la solution du transfert. Mais en juillet 37, le haut comité arabe rejeta catégoriquement l'idée de la partition. Au mois de septembre, la rébellion reprit de plus belle. Entre-temps, l'avènement du terrorisme juif en Palestine donna à nouveau du fil à retordre à la Grande-Bretagne. Pour la première fois le bilan des victimes arabes atteignaient plus ou moins le nombre de juifs tués au cours des pogroms et des émeutes arabes entre 1929 et 1936. Mais la rébellion s'était dégradée, plus d'Arabes périrent par le fait de leurs pairs palestiniens que par les Britanniques ou les juifs : les bandes s'affrontaient et se disputaient territoires ou butins. En 1938, la Grande-Bretagne reconsidéra sa politique en envisageant le retrait de son projet de partition, notamment à cause de la rébellion, mais aussi à cause de la menace du Japon, de l'Italie et de l'Allemagne. Il s'agissait de maintenir le calme au Moyen-Orient, car la région revêtait une importance stratégique, en raison de ses ressources pétrolières et des bases militaires britanniques qu’elle abritait. (175) Une nouvelle commission vit le jour. Son commissaire déclara un jour : « il n'est pas sage pour les juifs de favoriser le mouvement sioniste, car il s'agit de ce même nationalisme dont nous faisons grief à Hitler. La solution au problème juif est celle adoptée par les bolcheviques, à savoir l’assimilation. » (176) En outre, les Britanniques pensaient intégrer la Palestine à une structure fédérale arabe plus large. « En bref, il n'y aurait ni État juif, ni État arabe palestinien. » (177) Un livre blanc vit le jour qui imposait de sévères restrictions à l'achat de terres par les juifs. Il suggérait aussi la création d'un État palestinien indépendant. Mais le haut comité arabe refusa cette proposition car elle ne mettait pas immédiatement un terme à l'immigration juive, et reportait l'indépendance, en la subordonnant à de bons rapports entre juifs et Arabes. Selon les estimations, la révolte avait fait entre 3 et 6000 tués parmi les Arabes, et des centaines d'habitations arabes avait été détruites, alors que les juifs accusaient des pertes physiques relativement insignifiantes : quelques centaines de tués et plusieurs domaines détruits ou endommagés.
V) La seconde guerre mondiale et la première guerre, israélo-arabe (1939–1949)
Les Arabes soutinrent l'axe, car le souvenir des britanniques comme protecteur du sionisme était encore vif. « L'idéologie et le comportement racistes des Allemands ont peut-être, il est vrai, dérangé certains Arabes, mais l'Allemagne se trouvait loin, tandis que les Britanniques et les Français tant détestés n'étaient, eux, que trop présents. »
En 1938, Ben Gourion pouvait dire : « si j'avais la possibilité de sauver tous les enfants juifs d'Allemagne en les transférant en Angleterre, et seulement la moitié d'entre eux en les envoyant en Israël, je choisirais la deuxième solution – parce que nous ne devons pas seulement prendre en considération l'essor de ces enfants, mais aussi l'histoire du peuple juif. » (183) Les sionistes avaient proposé à Churchill d'organiser une armée juive. Celui-ci était favorable, car cela permettait à la garnison britannique de rejoindre le front de l'Europe. Mais derrière cette offre juive se cachait aussi la nécessité de disposer d'un corps de troupes bien entraîné capable de protéger la communauté contre les Arabes, dès que la guerre sera terminée. Et les deux parties comprirent également que c’était aussi « l'objectif et la conversion de la Palestine, en un État juif en récompense de leur assistance militaire », comme le formula lord George. (188)
Mais à la fin de la guerre, ce qui prit de l'importance, c'est l'impact qu'avait l'holocauste auprès des Américains. Les sionistes obtinrent leur soutien grâce à une propagande efficace et au poids électoral et financier des 5 millions de juifs implantés sur le territoire des États-Unis. Jusqu'en 44, l'administration Roosevelt accordait plus d'importance au pays arabes en raison de la manne pétrolière. Dans le même temps, les pays arabes fondèrent une ligue en 1945. Un des articles du protocole d'Alexandrie disait : « il ne peut être porté atteinte aux droits des Arabes de Palestine, sans danger pour la paix et la stabilité dans le monde arabe. » (193)
Une commission fut chargée d'évaluer le nombre de juifs pouvant émigrer en Palestine. La Grande-Bretagne renoncerait à son mandat et la Palestine passerait sous tutelle internationale. Et après un certain temps, un État palestinien et non pas, juif, indépendant serait établi. Après la visite du pays, un des membres de la commission déclara : « quand j'ai quitté Washington, j'étais presque résolument antisioniste. Mais lorsque vous constatez par vous-mêmes ce que ces juifs ont accompli en Palestine, les plus grands efforts de créativité du monde moderne. Les Arabes sont très loin d'en avoir fait autant et réduiraient à néant tout ce que les juifs ont réalisé. Nous devons les en empêcher. » (199) Pendant ce temps-là les juifs continuaient de cibler les Britanniques. Une explosion fit 91 victimes : « cet acte terroriste fut le plus importants de l'histoire de l'organisation (l’Irgoun). » (200) Le 4 octobre 1946, le président Truman déclara officiellement le soutien des États-Unis à la partition et à la création d'un État juif, indépendant, en appelant immédiatement à une immigration substantielle. Une décision qui était aussi le fruit d'une lutte passionnée pour s'attirer les voix des juifs de New York aux prochaines des élections législatives. Cependant, les actes « bestiaux » (203) continuaient : pour les Britanniques, « les méthodes draconiennes, si moralement répréhensibles de l’Irgoun, contribuèrent de manière décisive à transformer l'option de l'évacuation choisie en février 1947 en une ferme résolution de se libérer du fardeau que représentait le mandat. » (203)
Une nouvelle commission pilotée par l'ONU visita le pays. Ses membres furent accueillis par leurs hôtes juifs, qui veillaient à ce qu'ils rencontrent des colons parlant, leur langue (suédois, espagnol, serbo-croate, etc.). « Du côté arabe, par contre, ils ne croisèrent qu’âpreté, méfiance ou agressivité. La propreté et le développement des régions juives d'une part et, à l'inverse, la saleté et le retard des villes et villages arabes impressionnèrent les délégués étrangers. La communauté juive leur apparut européenne, moderne, dynamique ; un État en devenir. » (204)
La commission proposa le partage de la Palestine en deux États, l’un, juif, l'autre arabe, plus une tutelle internationale pour Jérusalem et Bethléem. Trois membres dissidents (Yougoslavie, Iran, Inde), proposèrent un État fédéral indépendant en Palestine, sous domination arabe.
Le vote à l'ONU requérant la majorité des deux tiers était compliqué. Les sionistes attendaient de l'Amérique qu'elle fasse pression sur leurs pays vassaux. Ainsi, la Grèce était menacée de perdre l’aide extérieure qui lui était allouée, et le Libéria entrevit un embargo sur son caoutchouc. Finalement, 33 pays votèrent pour le plan de partage, 13 contre et 10 s’abstinrent. Les pays arabes ne pouvaient comprendre pourquoi 55 % du territoire avait été alloué à 37 % de la population alors qu'elle n'en possédait concrètement que 7 %. « Les Palestiniens ne saisirent pas pourquoi il leur fallait payer pour l'Holocauste. Ils ne saisirent pas pourquoi il était injuste que les juifs constituent une minorité dans un État palestinien unitaire, alors qu'il était juste pour presque la moitié de la population palestinienne – population autochtone et majoritaire vivant sur sa propre terre, ancestrale – de se voir convertie du jour au lendemain en une minorité sous domination étrangère. » (cité p. 206) « D'une certaine manière, cette résolution, 181, représentait le geste de repentance de la civilisation occidentale, pour l'holocauste, de remboursement d'une dette due par des nations qui auraient pu en faire plus pour empêcher, ou au moins limiter l'ampleur de la tragédie. »
Débuta, alors ce que l'on peut appeler une guerre civile tant les populations étaient entremêlées. Les Arabes de Palestine représentaient entre 650 000 et 1,2 millions. Ils avaient la sympathie de tous les pays arabes autour d’eux. Mais le Yishouv possédait des avantages fondamentaux par rapport aux Arabes : organisation nationale pour la guerre, entraînement, effectifs, armement, production d'armes, moral et motivation, et surtout contrôle et commandement. Il possédait plus d’hommes en âge de servir dans l'armée, un fait démographique qui résultait de la politique, délibérément pratiquée depuis plusieurs années. Deux sociétés se faisaient donc face : l'une, extrêmement motivée, instruite, organisée et semi industrielle ; l'autre arriérée, en grande partie illettrée, désorganisée et agricole. Pour le villageois arabe moyen, l'indépendance politique et le statut national ne représentaient que de vagues abstractions ; son attachement allait à sa famille, à son clan, à son village et occasionnellement à sa région. En outre, des décennies de querelles avaient profondément divisé la société palestinienne. » (214)
Le Yishouv possédait aussi un proto-gouvernement, un cabinet exécutif, un ministère des affaires étrangères, une trésorerie, et la plupart des autres départements et services que compte un gouvernement, notamment un système scolaire autonome et opérationnel, un système de taxation, des agences pour la colonisation, et la mise en valeur des terres et même une puissante organisation syndicale. Il possédait aussi une élite très talentueuse. Et l'organisation sioniste mondiale très structurée avec de puissantes ramifications aux États-Unis et en Grande-Bretagne, capable d'apporter les ressources nécessaires dans les moments critiques. En 1948, Golda Meir récolta 50 millions de dollars, soit deux fois plus que la somme réclamée par Ben Gourion. Et elle récolta la même somme lors d'une seconde visite éclair. Cet argent permit de financer des cargaisons d'armes en provenance de Tchécoslovaquie qui s’avérèrent cruciales. Si, en théorie, les Arabes palestiniens pouvaient se raccrocher à tous les pays du monde arabe, ceux-ci, moins organisés moins généreux, ne leur offrirent pas grand-chose. (215)
Fin 47 et début 48, des centaines de civils arabes furent tués ou blessés dans des actions terroristes organisées par l’IZL. En représailles, des travailleurs arabes s’en prirent à leurs collègues juifs avec des marteaux, ciseaux, pierres et matraques. (220)
Le 14 mai, les dirigeants du Yishouv se rassemblèrent au musée de Tel-Aviv pour entendre Ben Gourion, lire la déclaration d'indépendance qui proclamait la création de l'État d'Israël.
Les forces en présence n'étaient pas égales : les FDI alignait 65 000 hommes à la mi-juillet, puis au printemps 49, 115 000. Alors que, dans le même temps, les armées arabes comptaient 40 000 hommes sur le territoire palestinien, et dans le Sinaï, et 55 000 en octobre.
L'ONU décréta un embargo sur les armes qui fut strictement respecté par les États-Unis et la Grande-Bretagne ainsi que par la France. Cet embargo desservit fortement la cause arabe, alors qu'il affectait le Yishouv de manière minimale. (240)
L’invasion arabe en Palestine fut une déroute, car elle n'était pas préparée. Les militaires le savaient, mais ils étaient poussés par des hommes politiques, des démagogues, la presse, la foule. Par ailleurs, le camp arabe était loin d'être uni. Par exemple, la Jordanie s'efforçait de négocier dans son coin avec les juifs.
« À la veille de l'invasion de 1948, les deux camps possédaient à la fois de puissants atouts stratégiques et de sérieux handicaps. Les Arabes avaient l'avantage de l'initiative et pouvaient compter sur un certain effet de surprise stratégique et tactique : ils frapperaient en effet les premiers, au moment et à l'endroit qu’ils choisiraient, et ils pouvaient s'attendre à bénéficier au moins temporairement d’une supériorité locale en terme d'effectifs et d’armement. De plus, les Arabes contrôlaient une grande partie des hautes terres (en Galilée, en Samarie et en Judée), alors que la mainmise juive se limitait surtout à la plaine côtière et aux vallées de Jezéel et du Jourdain. Les Arabes jouissaient aussi d’une écrasante supériorité en matière d'armes lourdes (artillerie, forces blindées, aviation). » (246)
Du côté juif, les avantages étaient les suivants : plus d'effectifs, mieux entraînés, une unité de commandement, des lignes de communication courtes. En optant pour une stratégie défensive, ils « livraient bataille sur leur propre terrain. Sa connaissance des lieux était bien sûre meilleure, et la stimulation morale d'autant plus grande que les juifs se battaient pour leurs propres maisons et champs. » (246) Le souvenir de l’holocauste étant encore frais, la motivation des hommes n'avait pas de limites. La motivation arabe était bien moins forte. S’ils voulaient « défaire les juifs - ces infidèles et usurpateurs – et rendre justice aux Palestiniens, leur pays, leur maison, leur famille n'était cependant pas en jeu. Les soldats arabes étaient et restaient des envahisseurs, se battant loin de chez eux pour une cause en grande partie abstraite qui les dépassait. » (246)
Les États-Unis condamnèrent l'agressivité de Israël et son mépris total des Nations unies.
La première guerre israélo–arabe se solda par une éclatante victoire israélienne et une humiliante défaite arabe : 6000 morts du côté israélien, 12000 du côté palestinien. Sans compter les pertes, égyptiennes, irakiennes, jordaniennes, syriennes et libanaises. Une onde de choc qui allait ébranler le monde arabe pendant des décennies. « C'était un fait accomplit : il existait désormais un État juif en plein cœur des mondes arabe et musulman. » (274) Les dommages économiques étaient faibles, compensés par les contributions financières de la communauté juive mondiale. « En l'espace de cinq ans, une profonde révolution démographique et agraire doublerait le nombre d'implantations juives dans le pays. » Du côté arabe, une économie déjà peu florissante fut encore affaiblie par un accroissement de la dette extérieure. Sans compter le fardeau des réfugiés, palestiniens sur leur territoire. Les Palestiniens perdirent une grande partie de leurs biens au profit des vainqueurs.
Les accords d'armistice n'était pas des traités de paix et mentionnaient peu d'éléments caractérisant normalement les rapports pacifiques entre États voisins, tels que les relations diplomatiques ou commerciales. Ainsi, pour les Arabes, les conventions d'armistice n'étaient que des accords de cessez-le-feu, sous-entendant par là, leur caractère temporaire. Cette lecture n'était pas forcément la même en Israël, où on voyait un accord de paix totale pour certains, quand d'autres partageaient le point de vue arabe. Émergea alors le problème des réfugiés : environ 700 000. À la fin de la guerre, moins de la moitié des Palestiniens habitaient encore chez eux : 150 000 en Israël, 400 000 en Cisjordanie, et 60 000 dans la bande de Gaza. « Les faiblesses structurelles qui caractérisaient la société palestinienne à la veille de la guerre, la prédisposaient particulièrement à la désintégration et à l'exode. Son organisation était en effet médiocre, sa cohésion sociale et politique très faible. De profonds clivages divisaient les populations rurales et urbaines, les musulmans et les chrétiens et les divers clans de l'élite ; en outre, il n'existait aucun dirigeant représentatif et aucune institution nationale efficace. » (278) « Une partie de la population rurale se trouvait sans terre et afflua dans les bidonvilles. De plus 70 et 80 % de la population était analphabète. « La classe défavorisée des villes et la paysannerie partageaient très peu, voire pas du tout, le nationalisme de l'élite urbaine. » (278) Les Israéliens expulsaient les Arabes (ils avaient manifesté depuis longtemps leur désir de « transfert des populations », Ben Gourion, en 1938). Compte tenu de ce qu'ils savaient de la réalité des réfugiés, ceux-ci résistèrent à ces expulsions.
Sous les pressions occidentales, les Israéliens se déclarèrent prêts à accepter le retour de 100 000 réfugiés en juillet 1949. Les Arabes estimèrent l'offre tout à fait insuffisante. L’État juif proposa aussi d’incorporer la bande de Gaza à son territoire et d’en absorber la population ce que l'Égypte refusa car c'était son seul butin de guerre. Les réfugiés voulaient rentrer chez eux et à l'exception de la Jordanie qui leur octroyait la nationalité, les États arabes ne cherchèrent guère à les intégrer car ils voyaient dans ces réfugiés et leur misère une arme non négligeable contre Israël. L'État hébreu refusa de les laisser rentrer d'une part parce qu'il avait besoin des terres et des maisons abandonnées pour les nouveaux immigrants et d'autre part il craignait leurs forces déstabilisatrices.
VI) 1949–1956
La situation affligeante des réfugiés palestiniens alimentait l'animosité des Arabes à l'égard de Israël. Elle témoignait de leur humiliation. (286)
Des tentatives de paix germaient entre pays. Par exemple la recherche d'un accord israélo-égyptien. Des documents révèlent qu’entre la fin de l'année 48 et le mois de juillet 52 plusieurs occasions de paix entre Israël et certains de ses voisins arabes se présentèrent effectivement. Cependant, elles ne furent pas mises à profit « parce qu’Israël ne se montra jamais disposé à transiger pour la paix, et que les dirigeants arabes se sentaient trop faibles et menacés par leur propre peuple, ainsi que par leurs voisins, pour tenter ou même envisager la paix, à moins qu'elle n'implique de réelles concessions de la part de Israël. » (294)
De nombreux heurts avaient lieu, notamment à la frontière. L'Égypte envoyait des individus appelés fedayin, « ceux qui se sacrifient. » Officiellement les États arabes étaient opposés à l'infiltration, mais les frontières étaient vastes. Entre 1948 et 1956, les infiltrés tuèrent environ 200 civils israéliens et d'innombrables soldats. Il y avait une atmosphère de guerre. Dans le camp Israélien, un fossé politique existait entre les activistes emmenés par Ben Gourion et bénéficiant du soutien de l'armée et des services de renseignement qui considéraient que les Arabes ne comprenaient que la violence, et les modérés.
Du côté de l'Égypte, sous le commandement de Nasser, une politique de guérilla qui consistait à chasser les Britanniques du sol égyptien avait lieu. En 1954, les deux gouvernements avaient signé un accord, prévoyant un retrait total des Britanniques dans la zone du canal de Suez pour le mois de juin 1956.
Israël craignait ce désengagement, car il voyait le début potentiel d'une guerre pour régler « la question de la Palestine ». D'autant plus que l'Égypte avait signé un contrat d'armement avec la Tchécoslovaquie qui bouleversait l'équilibre des forces. Israël signant de son côté avec la France. « Derrière ces accords se cachait la reconnaissance croissante d’une réciprocité d'intérêts. Principal appui politique et fournisseur militaire des rebelles du FLN qui se battaient contre la domination française en Algérie, Nasser était en effet devenu un ennemi commun. En juillet 1956, il procéda à la nationalisation du canal de Suez, propriété britannique et française ; il n'en fallait pas plus. » (312)
Mais avant cette guerre du Sinaï et de Suez, les hostilités entre l'Égypte et Israël se déclarèrent avec des massacres de part et d'autre.
L'expédition de Suez compromit irrémédiablement la position de la France et de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient, les États-Unis reprenant à leur compte le rôle de protecteur. L'Union soviétique s'engouffra aussi dans la brèche.
Le retrait israélien de l’Égypte fut moins rapide que celui des Britanniques et des Français. Nasser mentionnerait encore longtemps la nécessité de détruire l'État hébreu. Par la suite, Ben Gourion annonça que l'armistice de 1949 était caduque, et que son État n'autoriserait aucune force onusienne à se poster sur son territoire. En faisant référence aux droits historiques d’Israël, et en citant le royaume juif du sixième siècle, il envoyait un message clair : Israël n'avait aucune intention d'évacuer le Sinaï. L'ONU vota une résolution appelant les trois armées à évacuer immédiatement le territoire égyptien, qui fut adoptée à 65 voix contre une (celle d'Israël). Les États-Unis ne suivaient donc pas Israël. Car ils voulaient lutter contre l'influence soviétique et donc voulaient se concilier les Arabes.
« La défaite franco-britannique eut un profond retentissement. Grâce à la manipulation des médias, Nasser persuada son peuple et bien d'autres Arabes encore, de la victoire égyptienne. Le canal était plus égyptien que jamais, et le régime de Nasser, fermement établi, jouissait en plus d'un important soutien populaire à travers le monde arabe. » (329) Et bénéficiait en plus d'un important soutien soviétique : militaire, économique, politique. Israël avait totalement évacué le Sinaï et la bande de Gaza. L'Égypte avait atteint la position de leader incontesté du monde arabe. L'idée d'un troisième round, qui mènerait à la destruction de l'État hébreu, germait dans la tête des dirigeants arabes : dans une lettre adressée à Hussein, en 1961, Nasser écrit : « concernant Israël, nous pensons que l'épine enfoncée dans le cœur du monde Arabe doit en être extraite. » (330)
VII) La guerre des six jours (1967)
La guerre n’éclata pas dans un ciel serein. Les Palestiniens étaient revenus sur le devant de la scène, en créant l'OLP. Dont l'objectif avoué était de rendre justice au peuple palestinien et de démanteler l'entité sioniste. Le Fatah était la principale composante de l'OLP. Il a eu une suite d'escarmouches puis Nasser décida de fermer le détroit de Tiran. Pour Israël, c'était un casus belli. Ne rien faire indiquait une faiblesse qui pouvait compromettre sa sécurité. Les journaux comparaient Nasser à Hitler. La guerre se déclencha. La motivation de part et d'autre était inégale : si les Arabes éprouvaient de la haine ou au moins de l'hostilité, l'Israélien se battait pour sauver sa vie, sa famille et son foyer. Il y eut des dizaines de milliers de Palestiniens qui émigrèrent alors en Égypte. En juillet 1967, le gouvernement Israélien autorisa les réfugiés à revenir au pays, mais avant le mois de septembre. En pratique seulement 14000 sur 120000 revinrent.
La victoire israélienne favorisa grandement sa position internationale. L'Occident et surtout Washington percevait à présent le pays comme une superpuissance régionale et « un allié non négligeable parmi une volée d'États arabes imprévisibles et fragiles. » (360)
« En l'espace de six jours, l'équilibre géopolitique de la région avait été complètement bouleversé ou plutôt, comme la guerre elle-même l'avait démontré, le déséquilibre militaire déjà présent s'était aggravé. Trois États souverains avaient subi une terrible humiliation et le gouvernement israélien espérait à présent convertir cette écrasante victoire militaire en une réussite politique : les territoires conquis pourraient maintenant être échangés contre des traités de paix. Israël décréta que les anciennes frontières internationales entre Israël et l'Égypte et entre Israël et la Syrie serviraient de base au tracé des frontières permanentes : l'État hébreu désirait en effet se replier sur celles-ci et restituer le Sinaï et le Golan en échange de la paix. Cette décision ne fut jamais rendue publique, mais transmise au gouvernement américain, qui la communiqua au Caire et à Damas. En quelques jours, Israël essuya deux refus. La résolution ministérielle ne faisait aucune mention de la bande de Gaza, impliquant par-là qu'Israël désirait la conserver. » (360)
Mais la guerre avait ouvert une nouvelle voie, les Israéliens possédaient enfin une carte à échanger contre la paix. Mais certains courants virent le jour en Israël, comme un messianisme fondamentaliste, avide d’expansionnisme qui obtient finalement un soutien progressif au sein du gouvernement lui-même. La colonisation juive en Cisjordanie débuta à Jérusalem dès les premiers jours du cessez-le-feu le 14 juin. « L'objectif consistait à transformer l'ensemble de Jérusalem en une partie inaliénable d'Israël. » (361) Ben Gourion réclama également la démolition des murs de la vieille ville datant du XVIe siècle, afin que la ville ne soit plus divisée, proposition, rejetée par le gouvernement. « (Cette attitude reflétait en tout cas l'état d'esprit de la plupart des nouveaux conquérants, intéressés quasiment jusqu'à l'obsession par les vestiges archéologiques liés au passé juif, mais relativement indifférents aux antiquités des autres cultures.). » (362)
Comme le feraient remarquer par la suite de nombreux hommes politiques israéliens, arabes et américains, les colonies constituaient un obstacle majeur à la paix. Le gouvernement fournit une aide aux colons qu'ils agissent dans le cas d'une mesure étatique ou pas. « À la fin des années 70, certaines régions jadis inoccupées par les juifs, étaient concrètement et démographiquement devenue juives. La guerre des six jours accrut la population palestinienne d'Israël : 400 000 déjà vivaient à l'intérieur de ses frontières d’avant 1967 représentant la minorité arabe, on est dénombrait à présent 1,1 million supplémentaires avec 600 000 en Cisjordanie, 70 000 à Jérusalem-Est et 350 000 dans la bande de Gaza. Un général pouvait déclarer : « nous parlons de l'immigration des Arabes. Il convient de tout mettre en œuvre pour les pousser à partir quand bien même il nous faudrait les payer. » Le raisonnement était que privés de terres et de ressources, principalement en eau, et de développement industriel, les Arabes partiraient. En effet, l’émigration dépassa l'immigration : 20 000 en moyenne de différence annuelle. Pour les habitants des territoires, la leçon était claire : « ni la désobéissance civile, ni la résistance passive aisément matées, ne contrarieraient ni ne mettraient fin à la domination israélienne. Seule restait donc l'option de la lutte armée. » (372) Car, contrairement au discours israélien, l'occupation se fondait sur l'usage de la force, la répression, la crainte, la collaboration et la traîtrise, les coups et la torture, l'intimidation, l'humiliation et la manipulation au quotidien. » (372)
Le nationalisme palestinien se réveilla.
« Jusqu'en 1948, le conflit judéo-arabe était resté circonscrit à deux communautés ethniques ou nationales, sous domination ottomane ou britannique. Après la guerre de 1948–1949, il devint une lutte opposant essentiellement un jeune État juif aux pays arabes. Les Palestiniens, brisés et exilés pour la plupart, avaient été provisoirement tenus à l'écart. La guerre de 1967, plaça sous domination israélienne plus d'un million de Palestiniens, exaltant ainsi leur conscience nationale. Désormais représentés par l'OLP et les dirigeants locaux dans les territoires occupés, les Palestiniens regagnèrent rapidement le devant de la scène. Il devinrent une fois de plus l'épicentre du conflit, le point de mire de la diplomatie internationale. Dans le cadre de cet antagonisme, ils atteignirent bientôt un statut égal à celui des États arabes, bénéficiant d'un droit de veto, sur toutes les solutions envisagées par ces derniers avec Israël. Ils s’imposèrent bientôt comme les meneurs officiels de la lutte militaire contre l'État juif. Défaites, les armées arabes ne pouvaient offrir à Israël, aucune résistance digne de ce nom ; peut-être une guérilla pourrait-elle atteindre de meilleurs résultats. Ce fut sur la base de ce raisonnement, que naquit le mouvement de résistance palestinien, qui allait désormais, harceler Israël, le long de sa frontière sur le Jourdain, puis, à l'extrémité nord du territoire, le long de la frontière libanaise. » (375)
La faiblesse militaire et politique des États arabes aboutirent à un accroissement de l'influence soviétique.
L'ONU s’empara de la question avec la résolution 242 qui appelait à une paix juste et durable au Moyen-Orient fondée sur l'échange des territoires contre la paix. Israël devait se retirer des territoires occupés en juin 67 et les Arabes devaient accepter en contrepartie de mettre fin à l'État de belligérance et reconnaître la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de chaque État, de la région et leur droit de vivre en paix à l'intérieur des frontières sûres et reconnues.
VIII) La guerre d'usure
Après la défaite, l'Égypte voulait se venger. Fort du soutien soviétique, Le Caire choisit une guerre d'usure reposant sur un bombardement intermittent. Une telle guerre posait un dilemme à son adversaire, car Israël n'avait aucune envie de subir des pertes continues ni de s'aventurer de l'autre côté du canal. Finalement, à cause de pertes croissantes, Israël répliqua avec sa puissance aérienne. L'Égypte était de nouveau défaite, et le plan Rodgers qui envisageait la restitution des frontières de 1967, ne suffirait pas à calmer les ardeurs arabes. La guerre larvée continua. Nasser espérait l’appui soviétique. Ce dernier était réticent. Nasser joua alors sa carte maîtresse et menaça de présenter sa démission, suggérant ainsi qu'un leader pro américain pourrait lui succéder. Brejnev céda et consentit à assumer la défense aérienne. « Cette décision resta confidentielle : les militaires soviétiques déployés en Égypte durent revêtir l’uniforme égyptien et les avions porter les insignes nationaux. » (389)
Ainsi, aux yeux des Égyptiens, la guerre d'usure fut un succès. Après les défaites humiliantes son armée avait tenu bon grâce au concours des Soviétiques. Ils avaient infligé des pertes aux Israéliens, et ce, jusqu'à la conclusion d'un cessez-le-feu. « Les Égyptiens reprirent ainsi une assurance que les défaites de 1948, 1956 et 1967 semblaient avoir irrémédiablement sapée. » (397)
Inspirés par le FLN, une cellule de militants groupés autour de Yasser Arafat prit corps : le mouvement de libération nationale de la Palestine, le Fatah. Celui-ci rencontra le soutien croissant de la diaspora palestinienne. Le conseil national palestinien en exil publia une charte dans laquelle était affirmée le droit de retour des Palestiniens dans le pays et que la lutte armée était la seule voie de libération. L’OLP, entendait liquider la présence sioniste. La partition de 1947 n'avait aucune validité, et toute l'histoire politique de la Palestine fut déclarée nulle et non avenue. La charte récusait aussi les liens historiques spirituels unissant les juifs à la Palestine. Elle décrétait que le judaïsme n'était qu'une religion et jugeait le sionisme fanatique et raciste : « ses objectifs sont agressifs, expansionnistes et coloniaux. Ses méthodes sont celles des fascistes et les nazis. » (398) La charte appelait à la destruction de Israël, et stipulait que seule une minorité de résidents juifs pourrait continuer à vivre dans le pays.
Le Fatah devait reconnaître sa défaite, le soulèvement populaire ne prenait pas. D'autres organisations de résistance entrèrent en scène. Notamment le Front populaire de libération de la Palestine, fondé par Georges Habache d'inspiration marxiste qui boycotta tout d'abord l’OLP, puis finit par se rallier à lui en 1970. Il allait devenir le fer de lance du terrorisme international entre 1968 et 1971. La lutte armée était au cœur de la charte palestinienne, et Yasser Arafat fut nommé président du comité exécutif de l'OLP. Il s’opposa au détournement d'avions, et pris des mesures pour exclure le FPLP de l'organisation car les États arabes n'étaient pas d'accord avec ce type d’action politique. Le sud Liban devint alors le principal lieu de concentration de l'OLP et il le resterait jusqu'à l'invasion israélienne de 1982.
La stratégie du Fatah était de faire en sorte « que le monde perçoive l'existence du peuple palestinien ». Un problème de cohésion interne entra également en ligne de compte, les extrémistes de l'organisation réclamant davantage de militantisme, les modérés, acceptant la création de Septembre noir pour assurer leur propre survie. Il fut donc décidé en août 1971. (413) Après des attaques à l'étranger pendant plusieurs années, l’OLP dissolvait septembre noir à l'automne 73. Arafat se déclara ainsi hostile au terrorisme international en mars 74. Tout en soutenant l’intensification du conflit armé dans les territoires occupés, l’OLP cherchait aussi à renverser la monarchie en Jordanie, mais elle punissait les Arabes responsables d’actes terroristes à l'étranger. Des groupes dissidents comme Abou Nidal, continuèrent leurs actions terroristes contre Israël jusque dans les années 80.
« À force de résistance ou d'activités terroristes, le peuple palestinien fut mobilisé et motivé. Un peuple désespéré redécouvrit son identité et trouva le moyen d'exprimer sa volonté politique à travers la violence. » (421) Cette guérilla maintenait les États arabes engagés en faveur de la cause palestinienne. Du côté Israélien, le contrôle des territoires pervertissait « les principes démocratiques et juridiques du pays et, peu à peu, creusa de profondes fissures dans la société. La droite israélienne, dont le militantisme, le racisme et l'esprit d’annexion se renforçait sans cesse, vint à occuper l'avant-plan et à dicter de plus en plus au gouvernement la politique et l'attitude à suivre. En définitive, la dynamique de la politique israélienne et le poids de la botte de l'occupant allaient éveiller au sein de la population conquise de puissants courants fondamentalistes musulmans, qui refléteraient à de nombreux points de vue, l'évolution intervenue chez les juifs israéliens. » (421)
« Avec le recul, on s'aperçoit que les différentes campagnes palestiniennes menées hors du Moyen-Orient, depuis la fin des années 60 jusqu'aux années 80, eurent deux effets contradictoires : tandis que, d'une part, elles attirèrent le regard du monde sur le « problème palestinien », elles ébranlèrent, de l'autre, la sympathie internationale à la cause palestinienne ; les atrocités terroristes profitèrent donc grandement à la cause, mais la firent en même temps tomber dans le discrédit. » (421)
IX) La guerre d'octobre (1973)
Pendant la guerre d'octobre, aussi connue sous le nom de guerre du Kippour ou du ramadan, les présidents égyptien et syrien, Anouar El-Sadate et Hafez El-Assad s’efforcèrent de reconquérir les territoires perdus en 1967. Leur intention n'était pas de détruire Israël, quoique les dirigeants Hébreux aient pu penser dans les premières heures du conflit. Car les présidents savaient qu’une telle ambition dépassait leurs capacités et qu'Israël pouvait toujours recourir à la frappe nucléaire.
Dans un premier temps, Israël fut surpris par l'attaque égyptienne et syrienne. Les Israéliens perdirent environ 2300 hommes, 5500 blessés et 294 prisonniers. Les Égyptiens perdirent 12 000 morts, 35 000 blessés ainsi que 8400 prisonniers. La Syrie compta 3000, tués, 5600 blessés et 411 prisonniers. « Les pertes arabes en équipement furent encore plus disproportionnées. Mais « telles que les choses se présentaient le 25 octobre, l'Égypte comptait néanmoins deux victoires à son actif : ses forces armées avait enfoncé une importante barrière psychologique, effaçant la honte des défaites antérieures ; d'autre part, elles avaient conquis et maîtrisaient toujours deux bandes de territoire d'une dizaine de kilomètres de large dans le Sinaï occupé, bouleversant définitivement le statut quo politico-militaire d'avant-guerre. » (471)
En outre, l'Égypte eut recours à l'arme du pétrole contre l'Occident. Elle décida les États du Golfe à annoncer une augmentation générale des prix de pétrole de 70 % ainsi qu'une baisse progressive de la production. Jusqu'à ce qu'Israël se retire complètement des territoires occupés et rétablisse les droits légitimes des Palestiniens. Le 23 décembre l'OPEP doublait les prix du pétrole.
Le cessez-le-feu qui entra en vigueur dévoila une situation politique et militaire complexe. Les résolutions du conseil de sécurité orientaient vers un accord sur la résolution de 1967, c'est-à-dire vers la cession de territoires en échange de la paix et vers la négociation directe entre Israël et chacun de ses ennemis arabes. Conformément aux attentes de Sadate, la guerre avait brisé l'impasse politique qui existait depuis 67. Leur honneur restauré, les dirigeants pouvaient envisager un dialogue direct avec Israël. Kissinger persuada les deux camps de signer ce qui devint le premier accord et égypto-israélien. Ce qu'Israël refusait d'envisager en 1971, à savoir un retrait partiel du canal en échange d'une non-belligérance partielle de l'Égypte, il l’accepta après la guerre du Kippour. Par la suite, l'accord prévoyait une paix totale en échange de la totalité du Sinaï. La guerre du Kippour ébranla aussi profondément. La société israélienne : quatre ans plus tard, le Likoud, l'alliance de droite de Begin arrivait au pouvoir (en 1977) clôturant trois décennies de domination politique travailliste.
X) La paix israélo–égyptienne (1977–1979)
L'élection de Carter aux États-Unis, remit le processus de paix sur les rails. Selon lui, Israël devait se retirer des territoires, occupés en 1967. Et les Palestiniens devaient se voir accorder l'autodétermination. L’idée de larges négociations multilatérales recueillit le consensus au sein des dirigeants américains. L'élaboration d'un accord global requérait la présence de toutes les parties, y compris les deux superpuissances comme médiatrices.
Sadate n'était pas homme à couper les cheveux en quatre. Pour lui, l'obstacle était d'abord une barrière psychologique, une méfiance mutuelle qui empêchait d'aller de l'avant. « Aussi fallait-il une initiative spectaculaire pour faire sauter le verrou dans les mentalités. » (487) Il avait aussi conscience qu'il était impossible de battre et de détruire Israël, les forces militaires en présence étant inégales. Par ailleurs, la guerre avait grevé l'économie égyptienne et l'Égypte était trop pauvre pour supporter le fardeau d'une lutte interminable. Par contre l'idée d'une paix avec Israël pouvait assurer l'Égypte de l'aide des Américains, ce que l'état de guerre avait toujours entravé. C'est ainsi que Sadate se rendit en Israël en novembre 1977. Cette visite frappa de stupeur le reste du monde arabe. « Les opposants au rapprochement la considérait comme le prélude d'une trahison, un accord séparé israélo-égyptien qui entraînerait la défection du plus puissant pays arabe. Les Palestiniens furent particulièrement choqués. » Arafat et Assad publièrent un communiqué commun dans lequel ils condamnèrent la visite.
Ainsi, entre la visite de Jérusalem et la signature des accords de camp David en septembre 78, une succession d'attentats terroristes palestiniens frappèrent des objectifs égyptiens, israéliens et occidentaux.
Alors que Begin était aux États-Unis à Camp David, un rassemblement de 100 000 personnes à Jérusalem eut lieu en faveur de la paix. L'ambassadeur israélien à Washington, attesta que ce rassemblement avait contribué à persuader les négociateurs Israéliens de lâcher du lest. Par ailleurs, des membres appartenant au parti modéré, menaçaient de quitter la coalition si un accord n'était pas trouvé. Et donc un échec aurait pu provoquer des élections anticipées et réduire les chances de Begin de remporter un second mandat. (503) Ces accords n'étaient pas des traités de paix à proprement parler, dont les dispositions réglaient chaque question dans les moindres détails. Mais ils allaient constituer la base du traité de paix israélo-égyptien signé six mois plus tard et le fondement des accords entre Israël et l'OLP, conclus 15 ans plus tard, à Oslo, au Caire et à Washington, de 1993 à 1995.
Sadate rentré au pays fut soumis à de fortes pressions de la part, des autres dirigeants arabes et de détracteurs à l'intérieur même du pays, de la gauche, et des fondamentalistes égyptiens. Par contre, l'opposition israélienne aux accords de camp David ne prit jamais vraiment d'ampleur. Les deux négociateurs avaient conscience que Carter serait bientôt occupé à se faire réélire et donc ne pouvait prendre le risque de s'aliéner la communauté juive américaine dont le soutien financier électoral était indispensable. C'est la raison pour laquelle Begin avait tout intérêt à prolonger les négociations et à reporter la prise de décision aussi loin que possible.
Les grondements révolutionnaires en Iran jetaient un nouveau poids dans la balance. Ce sont eux qui activèrent la résolution de paix. Le renversement du shah d’Iran mettait en péril la position des États-Unis dans toute la région et forçait Carter à tenter rapidement de mener à bonne fin le processus de paix. Cette révolution iranienne persuada aussi Sadate qu'il fallait signer la paix au plus vite avant que le flot fondamentaliste ne submerge le Moyen-Orient.
Les trois parties se montraient satisfaites, et, depuis lors, le traité réglemente toujours les relations entre les deux pays. L'Égypte avait récupéré l'entièreté du Sinaï, et était libérée du fardeau économique et militaire qu’impliquait la lutte contre Israël ; Carter « avait réalisé un exploit de taille en politique étrangère, une prouesse historique qui réduisait considérablement le danger d'une future confrontation est-ouest » (527) ; Begin avait gagné la paix avec l'Égypte, et obtenu pour son pays des cieux plus cléments avec les autres pays arabes qui n’oseraient pu mener une guerre sans la participation de l'Égypte.
À l'exception du Soudan et du sultanat d’Oman, tous les pays arabes rompirent leur relation avec le Caire. Le siège de la ligue arabe fut transféré à Tunis et l'adhésion de l'Égypte à la ligue fut suspendue. L'Égypte était le centre naturel du monde arabe et Sadate avait fait le pari que les autres pays auraient à effacer leurs différends avec l'Égypte, et en fin de compte seraient contraints de la réinviter dans la ligue, voire même de lui emboîter le pas dans le processus de paix. Il avait vu juste : en 1989, tous les États arabes avaient rétabli les relations diplomatiques avec le Caire et le siège de la ligue avait regagné l'Égypte. En outre, au début des années 90, l'OLP, la Syrie et la Jordanie étaient engagés dans le processus de paix.
Mais cela ne pouvait pas aller plus loin étant donné la nature du gouvernement israélien et les exigences égyptiennes et palestiniennes, les pourparlers sur l'autonomie étaient voués à l'échec. De surcroît, le concept israélien d'autonomie ne prévoyait pas de transfert de compétences aux Palestiniens en matière de territoire, d’eau, de défense ou de politique étrangère ; l'occupation militaire devait se poursuivre et le réseau de colonies resterait intact ; tous les efforts étaient donc déjà condamnés d'avance aux yeux des Égyptiens, des Américains et a fortiori des Palestiniens.
Les étapes intermédiaires d'application allait être bousculées par l'assassinat du président Sadate et l'évacuation israélienne du Sinaï ; mais elles eurent finalement lieu. Cet assassinat s’expliquait par le fondamentalisme islamique, l'opposition au traité de paix, et la haine du président considéré comme un tyran.
Finalement, peu d'observateurs auraient prédit en 1977 et 1979 que la mise en œuvre du traité rencontrerait aussi peu de difficultés. « Néanmoins, les Israéliens reprochèrent maintes fois à l'Égypte de ne jamais avoir vraiment procédé à la normalisation des relations. » (534) Si les Égyptiens respectaient bien la lettre du traité, il n'en portaient pas moins préjudice à l'esprit du traité en empêchant le développement de véritables liens économiques et culturels avec Israël : pas d'achat de marchandises israéliennes à l'exception du pétrole, aucune exportation. Des milliers de touristes israéliens se rendaient en Égypte chaque année, alors que l'Égypte empêchait généralement ses ressortissants de visiter Israël. Les médias égyptiens poursuivirent leur propagande traditionnelle anti-israélienne. Institutions et associations professionnelles égyptiennes continuèrent à boycotter Israël. Les Égyptiens affirmaient qu'Israël avait pratiquement totalement manqué à la parole donnée concernant les Palestiniens. En particulier concernant l'autonomie des Palestiniens.
Mais dans l'ensemble la paix tint bon, elle servit d'exemple au reste du monde arabe en offrant une solution alternative viable à une situation d'hostilité continue et interminable.
XI) La guerre du Liban (1982–1985)
L'Égypte neutralisée par les clauses de son traité de paix, le gouvernement Begin monta une vaste offensive contre l'OLP au Liban, avec des raisons remontant loin dans l'histoire. En effet, la carte du futur État juif, présentée par l'organisation sioniste à la conférence de la paix à Versailles en 1919, intégrait le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani. Pendant des décennies, la possibilité d'une alliance avec les chrétiens hanta l'imaginaire sioniste. Et dans une moindre mesure, celui des maronites. Les maronites qui s'étaient enfuis au mont Liban afin d' échapper aux persécutions des musulmans au septième siècle, considéraient leurs terres comme un havre pour les martyrs chrétiens des quatre coins du Levant, de la même manière que les sionistes voyaient la Palestine comme un refuge pour les juifs persécutés. Les deux communautés encouragèrent leurs frères à quitter l'étranger pour regagner la patrie. Toutes deux tournées vers le négoce, elles intensifièrent les relations commerciales de façon spectaculaire au cours des années 1930.
Côté israélien, les militaires nourrissaient le projet d'un pays libanais frère. Le premier ministre israélien rapporta ainsi les dires de Dayan (en 1955), chef d'état-major : « tout ce dont nous avons besoin, c'est de trouver un officier ne fût-ce qu'un capitaine, de le gagner, à notre cause ou de le soudoyer, pour qu'il se présente comme le sauveur de la population maronite. Les FDI pourraient ensuite entrer au Liban, se rendre maîtres du territoire nécessaire et établir un gouvernement chrétien qui serait l'allié d’Israël. La région située au sud du fleuve Litani sera annexée en sa totalité par Israël. » (541) 30 ans s’écoulèrent avant que Menahem Begin et Ariel Sharon ressuscitent le rêve de Ben Gourion et de Dayan en lançant l'invasion du Liban en 82.
Une guerre – civile – se déclencha entre chrétiens et musulmans. Malgré l'effort de Arafat pour rester à l'écart, le Fatah dut prendre partie des musulmans.
Après que Menahem Begin eut été élu à la tête du conseil des ministres en mai 77, les chrétiens libanais appelèrent Israël pour les défendre. Beggin était fort attaché à l'histoire et il n'était pas un homme « à manquer l'occasion de montrer au monde comment son peuple magnanime profondément humain volerait au secours des chrétiens du Liban et les préserverait d'un génocide par les musulmans » ce que n’avaient pas su faire l’Europe et les États-Unis, pendant la deuxième guerre mondiale. À l'instar de Ben Gourion, Begin rêvait de voir un jour se former une alliance entre les minorités du Moyen-Orient contre les musulmans.
Le point de départ de l'intervention israélienne au Liban fut l'attaque par des membres du groupe de Abou Nidal de l’ambassadeur israélien à Londres. C'est Sharon qui mena la bataille dans le but à la fois d'écraser l'OLP, de chasser ses membres du Liban, de déloger, les Syriens et d'installer un gouvernement pro-israélien.
Le conseil de sécurité des Nations unies exigea un retrait israélien immédiat. Les États-Unis votant en faveur de cette résolution, mais seulement pour la forme. La politique américaine au Liban consistant à tenir les Soviétiques à l'écart et empêcher leurs protégés locaux d'accéder au pouvoir.
Bien qu'il y ait eu un cessez-le-feu avec les Syriens, les Israéliens resserrèrent l’étau autour des défenseurs de Beyrouth, combattants de l'OLP et Syriens, dans ce qui fut un siège sanglant de neuf semaines s’ajoutant à l'embargo sur les produits d'alimentation, le carburant, les coupures d'électricité et d’eau. Ce siège traumatisa la société israélienne et provoqua division au sein de l'armée, et fâcha l'Occident. Les forces israéliennes avaient beau cibler des objectifs militaires, elle ne pu éviter la mort de nombreux civils. « La popularité d’Israël connut une chute vertigineuse dans les sondages d'opinion américains. » (579) L'OLP campait sur ses positions, encouragée par l'attitude critique des pays d'Europe occidentale, l’irrésolution américaine, la couverture médiatique mondiale et l'opposition travailliste en Israël. Et bien que les forces israéliennes avaient eu le dessus de juin à août 1982, elles se firent voler l'initiative par les Syriens les trois années suivantes et assistèrent à leur succès progressif. Tout bascula avec l'assassinat au mois de septembre de Béchir Gemayel, le seul homme politique maronite libanais d’envergure et de charisme. Israël aliéna toutes les factions du Liban, puis au milieu de l'année 1985 finit par reculer jusqu'à sa position initiale dans la zone de sécurité, bordant la frontière. Derrière, les Israéliens laissaient un pays plus soumis que jamais à l'emprise de la Syrie, ainsi qu'une guérilla active et déterminée avec notamment le Hezbollah. Les forces chrétiennes libanaises elles aussi auteurs de meurtres de masse comme les massacres de Sabra et Chatila que Sharon semblait couvrir. Un militaire Israélien déclara, « nous avons tous été insensibles, c'est tout ». « Il n'avait pas tout à fait tort : la guerre de 1948 et les décennies ultérieures de lutte contre les Palestiniens qui culminèrent avec la guerre contre l'OLP à l'été 1982 avait désensibilisé la population israélienne, les FDI en particulier, envers les souffrances et la mort des Palestiniens. Dans une certaine mesure, cet endurcissement avait tracé la voie aux horreurs de Sabra et Chatila. » (594) Le 25 septembre, la population se fit entendre dans le rassemblement, le plus important jamais organisé avec 400 000 personnes pour réclamer la création d'une commission d'enquête et la démission du gouvernement. La conclusion de la commission fut assez frileuse à l'égard des FDI, qui évacua finalement le Beyrouth le 26 septembre.
L'accord entre Israël et Syrie stipulait le retrait de Israël jusqu'à la frontière internationale et mettait fin à l'État de guerre existant entre eux depuis 1948. Mais ces dispositions supposaient le retrait de l'armée syrienne du Liban, une condition à laquelle Assad n'avait aucunement intention de se soumettre.
Le Hezbollah entendait expulser tous les étrangers du Liban y compris les soldats de la force multinationale et ensuite instaurer une république islamique sur le modèle iranien. Il voulait aussi mener le Jihad contre Israël, restituer Jérusalem et la Palestine à l'islam et défaire l'Occident chrétien ou du moins briser son influence dans le monde musulman.
Ainsi que le reconnut un cadre du service intérieur israélien, la libanisation signifiait se livrer à des actes ignobles dans une lutte transformée en véritable Far-West.
Le président syrien Assad résuma l'expérience israélienne au Liban : « l'État hébreu pensait que l'invasion ressemblerait un parcours de santé et qu'il pourrait installer un État fantoche. Begin avait promis aux Israéliens : votre sécurité sera assurée pour 40 ans. Mais il ne réussit même pas à garantir la sécurité pendant 40 jours. La population du Liban refusant de se résigner devant l'oppression étrangère. Les Israéliens n’eurent pas de répit ni de tranquillité au Liban et, au contraire, furent contraints de vivre dans la crainte et la terreur. Pendant ces trois années, ils consacrèrent toutes leurs ressources à la recherche d'une échappatoire et de meilleures mesures de protection. Aujourd'hui, comme hier, ils ne connaissent ni le lieu ni l'heure où ils essuieront des tirs ou seront piégés par une bombe que ce soit dans leurs camps, en patrouille ou en convois. Car l'esprit de sacrifice dans les rangs du mouvement de résistance nationale libanais est sans bornes. » (604)
Israël avait connu quelques succès : l'infrastructure militaire de l'OLP avait été détruite et chassée de Beyrouth, elle avait perdu un grand nombre de combattants. Ses unités s'éparpillaient aux quatre coins du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Mais l'OLP, en tant que telle, n'était ni détruite, ni même profondément meurtrie. Elle devenait surtout un interlocuteur incontournable. Israël se rendait compte, surtout qu'elle avait installé un ennemi encore plus fanatique efficace que l'OLP avec le Hezbollah.
L'hégémonie syrienne au Liban entraîna la quasi suppression des luttes intestines qui caractérisait le pays depuis 1975.
XII) L'intifada
En 1987, éclata l'intifada mot arabe désignant une secousse à la manière d'un chien qui se débarrasse d'une puce, 20 ans après le premier rappel à la révolte de Yasser Arafat contre l'occupation israélienne en Cisjordanie. Cette insurrection prit l'OLP au dépourvu et suivit un cours opposé à ce que prônaient les dirigeants. Ce n'était pas une rébellion armée, mais une campagne de résistance civile, massive et soutenue, marquée par des grèves et des fermetures de commerces et ponctuée de manifestations violentes contre les forces d'occupation. La frustration des aspirations nationales des 650 000 Palestiniens dans la bande de Gaza, 900 000 en Cisjordanie et 130 000 à Jérusalem-est en était le moteur. Un désir de vivre dans un État palestinien et non pas comme apatrides. Avec le sentiment d'être des laissés pour compte, en comparaison de ce que vivaient leurs voisins juifs.
De 1967 à 1987, la communauté des fidèles musulmans doubla dans la bande de Gaza tandis que le nombre de mosquées grimpait de 77 à 160. Dans les villes et villages, les intégristes imposaient de nouvelles normes : les cinémas fermaient, les vitrines exposant des mannequins vêtus de robe étaient saccagés, les cafés servant des boissons alcoolisées incendiés, les gens utilisant leur main gauche pour manger furent battus. De nombreuses femmes adoptaient le voile et de jeunes hommes commencèrent à se laisser pousser la barbe.
Mais ce furent davantage des motifs de nature socio-économique et psychologique qui poussèrent les Palestiniens à descendre dans les rues. Le revenu annuel par habitant dans la bande de Gaza avait bondi de 80 à 1700 $ entre 1967 et le début des années 80 : en Cisjordanie, le produit intérieur brut fit plus que tripler sur cette période. Malgré ces progrès, la frustration politique, la colère, et le sentiment de discrimination et d'inégalités par rapport aux Israéliens, continuaient de croître. Avec 1600 personnes au kilomètre carré, la bande de Gaza possédait en 1987 l'une des densités de population les plus élevées au monde. Dans les camps, l'eau courante manquait et les eaux usées s’écoulaient à même les rues. Les réserves souterraines en eau étaient détournées au profit de Israël. En moyenne, les colons de Cisjordanie utilisaient 12 fois plus d’eau que les Palestiniens. La superficie des terres arabes irriguées déclina de 30 % entre 67 et 87. « Les politiques gouvernementales subordonnaient les territoires aux besoins économiques israéliens et étouffaient le développement des Palestiniens.» (614) L'administration israélienne empêchait les Arabes d'établir des manufactures afin de protéger les industries israéliennes, ainsi qu'en interdisant aux fermiers de cultiver certains produits agricoles. Du fait de cette absence de développement, une part importante de la main-d'œuvre des territoires cherchait un emploi en Israël : 40 % de la population active travaillait en Israël en se contentant de tâches ingrates et de salaires faibles sans pouvoir prétendre à aucun avantage en nature ni de prestations sociales.
En 1986 et 87 le taux de natalité progressa deux fois plus rapidement que le rythme de construction de nouveaux logements.
Dans les années 90, avec l'émergence du terrorisme intégriste musulman, les Israéliens réduisirent les effectifs de travailleurs palestiniens et les remplacèrent par des étrangers venus de Thaïlande ou de Roumanie. Ainsi bloqués dans leur territoire, les travailleurs arabes se trouvaient dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi. Entre 10 000 et 20 000 Palestiniens quittaient les territoires chaque année. Mais la guerre entre l'Iran et l'Irak empêcha ces débouchés et les Palestiniens devaient regagner leur territoire. De plus entre 1988 et 1994 des centaines de milliers de juifs soviétiques arrivèrent en Israël, accaparant les petits boulots autrefois confiés aux Palestiniens. Le taux de chômage monta alors en flèche dans les territoires. Les Palestiniens pouvaient alors penser que c'était la stratégie israélienne pour les chasser : en somme, la prolongation de 1948, par d'autres méthodes. Ariel Sharon emménagea dans un appartement du quartier musulman de la vieille ville, ce qui est aux yeux des Arabes constituait une sorte de provocation.
Aux attaques anti israéliennes, répondirent une intensification de la brutalité et de nouvelles sanctions collectives, comme des couvre feu de longue durée. Au fil des décennies, les forces de sécurité détinrent des dizaines de milliers d'habitants. « Toutes ces mortifications donnèrent à la population des territoires une intense soif de vengeance. » (617)
Comme les frères musulmans s'étaient abstenus de recourir à la violence durant les années 70, le gouvernement militaire israélien les avait donc soutenus, croyant trouver en eux un contrepoids à l'OLP. Mais l'avènement de Khomeyni en Iran et les victoires chiites au sud Liban provoquèrent un changement d'atmosphère chez les intégristes. Ils voyaient la culture des Israéliens comme blasphématoire et subversive, vision notamment alimentée par la recherche par les services intérieurs de collaborateurs parmi les revendeurs de drogue et les prostituées. Ils assimilèrent donc la domination israélienne à la progression généralisée des drogues et au relâchement des mœurs dans leur propre société. Ils fustigèrent la propagation de la corruption juive en Palestine. Ils espéraient que les attaques des militants contre les Israéliens, pousseraient ces derniers à répondre par de violentes contre-mesures, poussant ainsi les Palestiniens au soulèvement. Bien qu'ayant des désaccords politiques avec la branche laïque du Fatah, les deux groupes étaient d'accord pour mettre fin à l'occupation. Les violences prirent une ampleur sans précédent, et se reproduisirent avec une fréquence inouïe. Les Palestiniens voulaient se débarrasser des Israéliens et améliorer leurs conditions économiques. Mais ils regardaient aussi l'établissement de leur propre État comme le prochain objectif. Et parmi les fondamentalistes, l'intifada n'était qu'un prélude visant à éliminer la présence sioniste sur cette terre. Les émeutiers faisaient preuve d'une disposition au sacrifice jusqu'alors presque inconnue des Israéliens.
Une nouvelle organisation, le Hamas, apparut. Elle visait à l'islamisation du pays et était ouvertement antisémite et antisioniste, imputant même aux juifs les révolutions française et russe ainsi que la Première Guerre mondiale. (627)
La tactique insurrectionnelle avait pour but de conserver l'image populaire de la révolte avec les Palestiniens dans le rôle de David contre le Goliath israélien. Aussi étaient proscrites les armes à feu. « Les Palestiniens comprenaient que la lutte se joureait en grande partie sur les écrans de télévision occidentaux. » (629)
L'invasion du Koweït par Saddam Hussein en août 1990, revitalisa les forces de l'intifada. Le leader irakien incarnait un sauveur potentiel qui bravait l'Ouest. Surtout que celui-ci endossa les traits du défenseur des Palestiniens.
La signature à Oslo du premier accord de paix entre l'OLP Israël, clôtura l'intifada en septembre 1993. Cet accord venait après une conférence de paix internationale sur le Moyen-Orient réunie à Madrid, à la suite de laquelle le terrorisme fondamentaliste se déchaîna loin dans les années 90 et causa un bilan bien plus lourd que l'intifada. À la suite de la victoire travailliste en Israël, le Hamas et le Jihad redoublèrent d'efforts pour entraîner les Israéliens dans une spirale répressive susceptible d'enrayer le processus de paix.
L'accord de paix marquait l'impasse dans laquelle l'intifada aboutissait : « les Palestiniens se trouvaient dans l'impossibilité de chasser les Israéliens des territoires, et les Israéliens s'avéraient incapables de juguler les violences. Cette situation rendait l'occupation de plus en plus gênante et incitait les deux parties à revoir entièrement leur politique. En espace, de quelques mois, l’OLP accepta de reconnaître l'État d'Israël, de conclure la paix avec lui et de constituer une entité autonome dans une portion réduite de la Palestine. De son côté, Israël consentit quelques mois plus tard, à reconnaître l'OLP, et à évacuer une grande partie, sinon, la majorité, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. » (646) Le soulèvement avait provoqué une crise économique de grande ampleur, avec une chute du niveau de vie des Palestiniens de 35 %. Mais il avait aussi permis d'élever le statut de la femme. Ces évolutions engendrèrent un revirement psychologique profond et peut-être durable dans la société palestinienne. Un sentiment d'unité apparaissait d’appartenir à une nation.
L'intifada porte un coup dur au moral des FDI, et de nombreux officiers quittèrent l'armée.
La Jordanie avait rompu ses liens légaux et administratifs avec la Cisjordanie, indiquant ainsi que si celle-ci se défaisait un jour de l'emprise israélienne, elle deviendrait le fief de l'OLP, plutôt que de retourner à la Jordanie, ce qui dérouta les Israéliens qui croyaient dans cette solution.
En reconnaissant Israël et en renonçant à l'action terroriste, le conseil national palestinien permettait cette solution de paix avec une coexistence pacifique de deux États. Cependant, la situation demeurait fragile.
XIII) Enfin la paix ?
Avec l'élection de George Bush et l'arrivée massive de juifs en provenance de l'Union soviétique, les accords de paix furent accélérés. Baker déclara : « le temps est venu pour Israël d'abandonner une fois pour toute la vision irréaliste d'un État juif aux frontières plus vastes. Il faut renoncer à l'annexion, mettre fin aux activités de colonisation, tendre la main aux Palestiniens, comme des voisins aux droits politiques légitimes. » (661)
Les Palestiniens critiquaient ce qu'ils considéraient comme la politique de deux poids, deux mesures de l'Occident, avec un souci de l'occupation du Koweit, mais une indifférence devant l'occupation israélienne. Les États-Unis eurent un moyen de pression sur Israël car l'État hébreu voulait des garanties américaines pour un emprunt de 10 milliards de dollars.
La fin de la guerre froide et le retrait soviétique de la scène internationale, puis la guerre du Golfe avait affaibli les Arabes et renforcé leur flexibilité. Combien de temps les régimes laïques relativement modérés du Moyen-Orient, pourraient tenir face aux forces ascendantes de l'intégrisme musulman ? La donne était donc nouvelle, et avec l'arrivée des travaillistes au pouvoir un accord vit le jour. Deux tiers des Israéliens interrogées se montraient favorables à cet accord. Les chiffres palestiniens reflétaient les mêmes proportions. Mais sous la houlette du Hamas et du Jihad, une minorité se lança dans une campagne destinée à faire dérailler le processus de paix. Le Hamas interdit à ses hommes de se heurter à l'OLP, et Arafat, soucieux d'éviter une guerre civile, n'essaya pas de réfréner la violence des intégristes. Il pensait en outre que ces attaques pousseraient Israël à accélérer son retrait.
Les territoires furent gérés à la fois par des hommes de l'extérieur et des militants de l'OLP. Arafat serait plus tard accusé d'avoir instauré un régime corrompu extrêmement autoritaire. Faute de liquidités, l'autorité palestinienne se retrouva dans l'incapacité de faire face aux dépenses courantes et de développer les infrastructures. L'enthousiasme retomba. Les attaques terroristes entraînèrent le bouclage des territoires et l'aggravation de la situation économique des Palestiniens. Arafat perdit progressivement la faveur de la population et ses rivaux intégristes gagnèrent en popularité. En matière de sécurité, Palestiniens et Israéliens étaient confrontés à un cruel dilemme : la déclaration de principe rendait Arafat responsable de la lutte antiterroriste à l'intérieur des régions autonomes. Mais s’il réprimait le Hamas et le Jihad islamique, il arrêtait et torturait les porteurs mêmes du flambeau de la libération. Et en protégeant les Israéliens, il s’aliénait une part croissante du peuple palestinien.
Au moment de l'assassinat de Rabin le 4 novembre 1995, l'État hébreu avait-il accepté au conditionnel ou d'une autre manière, le repli sur les lignes du 4 juin 1967 ? L'incertitude demeure. À sa suite, Peres espérait conclure un accord, mais Assad refusait de se laisser bousculer. Peres opta finalement pour la tenue d'élections anticipées qu'il perdit. L'arrivée au pouvoir de Benjamin Nétanyahou ne présageait rien de bon pour le processus de paix avec la Syrie et le Liban. En effet, à chaque attentat perpétré par les islamistes, la droite, manifestait bruyamment son opposition au processus de paix. « Les ennemis musulmans de la paix alimentaient et stimulaient ainsi leurs homologues israéliens. » (685)
Si la toute première assemblée en territoire palestinien abrogea les articles de la charte palestinienne appelant à la destruction d'Israël, elle n'en promulgua aucune autre dépourvue d'un tel contenu, « permettant à la droite israélienne d'affirmer non sans force que l'ancienne charte restait d'application. » (690)
L'opinion publique israélienne assimila Arafat à un processus de paix qui avait porté le terrorisme à son apogée, et créé l'insécurité, ainsi qu'un partenaire indigne de confiance.
Nétanyahou conduit cependant les accords d'Oslo II et d’Hébron malgré des réticences dans son camp. L'armée Israélienne se retira en grande partie d’Hébron, et l'autorité palestinienne put hisser le drapeau palestinien sur l'ancien fort de la police britannique, qui, depuis trois décennies, servait de quartier général au gouverneur militaire. « Pour la première fois, un gouvernement mené par le Likoud avait évacué et cédé à l'OLP, un morceau de la terre d'Israël – certes de petite taille, mais à forte teneur émotionnelle et d'une grande importance symbolique. Sous le poids de la pression internationale, des menaces palestiniennes implicites, et de l'opinion publique, Nétanyahou avait aussi ajouté une pierre décisive à l'édifice d’Oslo, dont les échanges « terre contre paix » constituaient l'assise, et engagé son gouvernement à poursuivre dans cette voie. » (696)
XIV) Les 19 mois d’Ehoud Barack
Sous sa présidence les militaires Israéliens quittèrent le Liban. À la suite de la mort de Assad, son fils lui succéda. Celui-ci réclamait la restitution du Golan dans sa totalité en échange de la paix. Il éloignait ainsi la possibilité d'une reprise des négociations israélo–syriennes.
Dans le même temps, les pourparlers avec les Palestiniens avaient repris et en mars 2000, Israël avait accédé à un nouveau transfert de territoire en Cisjordanie. Mais les négociations piétinèrent, et une nouvelle explosion se déclencha. Celle-ci trouvait sa genèse dans 52 ans de marginalisation et de discrimination des Arabes au sein de la société israélienne ainsi que dans leur radicalisation progressive avec l'intégrisme musulman. Cette indifférence à la minorité arabe qui votait en masse pour Barak explique en partie cette seconde intifada.
Les propositions de paix avancées par Barak contribuèrent également à l'éclatement des violences. Il avait promis une rupture totale avec les années Nétanyahou. Les dirigeants de l'OLP, de leur côté s'étaient résignés à accepter Israël dans ses frontières d'après 1948 et donc, Israël conserverait 78 % de la Palestine historique. Cependant, l'OLP aspirait aux 22 % restants, soient la Cisjordanie et la bande de Gaza dans l'attente d'un minimum de justice. Si Barak avait approuvé l'établissement d'un État palestinien, il avait suggéré que les Arabes se contentent de 84 à 90 % de ces 22 %. Il avait même insisté pour que les colons se voient rattachés à l'État hébreu. Par ailleurs les Israéliens devaient garder le contrôle du territoire compris entre Jéricho et Jérusalem aux limites très élargies, coupant ainsi le futur État palestinien en son centre. Les propositions de Barak reposaient aussi sur l'hypothèse d'un non retour des réfugiés palestiniens dans leur foyer. Ils ne pouvaient pas revenir en Israël mais en Cisjordanie ou à Gaza.
L'intifada se déclencha donc, et les soldats Israéliens firent preuve d'une extrême retenue face aux provocations palestiniennes. Cependant, le conseil de sécurité de l'ONU condamna l'usage excessif de la force contre les Palestiniens. Mais la médiatisation était en faveur de ces derniers. (719)
Il y a eut cependant de terribles pertes économiques pour les Palestiniens, car Israël suspendait différents paiements de même que des pays occidentaux ou des États arabes en raison du chaos et de la corruption. Cette situation fit le jeu de la droite, israélienne : une fois encore, la violence arabe persuada les centristes indécis de voter pour la droite qui promettait de renforcer leur sécurité personnelle. L'élection était jouée d'avance dominée par le rejet d’Arafat. Sharon se retrouva donc à la tête du pays avec 62,4 % des voix : jamais victoire n'avait été si éclatante de mémoire d’Israéliens. L'absentéisme également fut record.
Conclusions
En 1938, Ben Gourion déclarait : « quand nous disons que les Arabes sont les agresseurs, et que nous nous défendons, ce n'est qu'à moitié vrai. En terme de sécurité et de vie quotidienne, certes, nous nous défendons. Mais cette lutte ne représente qu'un aspect du conflit, qui est en substance d’ordre politique. Et en termes politiques, nous sommes les agresseurs, et eux se défendent. » (731)
1) Le mouvement sioniste s’orientait vers la Palestine à retrouver les terres ancestrales par l'achat à partir de 1880 – et non la conquête – de terres et l'établissement des colonies. « L'idéologie et les pratiques sionistes étaient expansionnistes par essence et par nécessité. Chaque colonie établie prenait conscience de son isolement et de sa vulnérabilité, et encourageait donc spontanément la construction de nouvelles implantations juives à ses abords. » (732) Et ainsi de suite. Après la guerre des Six jours, la même logique justifierait l'extension des implantations israéliennes sur le plateau du Golan et autour de Jérusalem.
2) L'expansionnisme sioniste se fondait également sur une logique externe. Des juifs désemparés cherchant à échapper à la persécution.
3) Il était également politique, puisque son but avait été de convertir toute la Palestine en un État juif.
L'expansion se déroula en deux poussées brèves, mais considérables : l'offensive militaire de 1948, et celle de 1967.
Dès le départ, les Arabes locaux qui ne constituaient certainement pas un peuple distinct, supportaient mal l'afflux : ils parlaient d'invasion. Paradoxalement la poussée et la menace sioniste engendra une conscience collective et un nationalisme distinct pour les Arabes de Palestine dont les leaders sionistes n'avaient pas pleinement conscience. Ils ignoraient le demi-million qui habitait le pays en 1880, 700 000 en 1914 est 1 250 000 en 1947. Les mémoires des colons évoquent rarement leur existence. « Ils tendaient à assimiler les populations locales au paysage, à les utiliser au besoin comme autant d'objets, et non comme des êtres humains aux droits et aspirations légitimes. » (733) De l'autre côté, les Arabes se montraient peu disposés à les comprendre. « Ce manque mutuel d'empathie caractérise assurément le conflit depuis lors. » (734) « Entre les deux communautés de Palestine existait un fossé décisif de 40 à 50 ans en termes de développement et de conscience politique. » (735) « Face à l'armée britannique et la milice juive, la foule arabe et les guérilleros, de 1920-21, 1929 et 1936-39 ne réussirent qu’à égratigner la carapace de l'entreprise sioniste. » (736) La commission Peel de 1937, proposait une solution fondée sur une partition attribuant 20 % du territoire aux juifs le reste allant aux Arabes. « Ben Gourion répéta à plusieurs reprises que ce mini État ne constituait qu'un tremplin pour une future conquête juive de tous les territoires : la Palestine devait être reprise par étapes. » (737) Le transfert des populations eut lieu et quelques Arabes vendirent leurs terres mais la grande majorité de la population refusa de se laisser acheter. La partition avait été la recommandation principale de Peel et Ben Gourion avait accepté. Mais cette approbation était sans conviction et ne reflétait en réalité, aucune sincérité. Quand la communauté internationale proposa de nouveau la partition, cette fois plus favorable aux juifs en 1947, elle fut une fois de plus acceptée et approuvée mais de manière beaucoup plus sincère qu'auparavant. Cependant l'idée expansionniste du grand Israël existait toujours même s'elle avait perdu un peu de son ardeur du moins jusqu'en 1967. À cette date, la conquête de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, ainsi que du Sinaï et du plateau du Golan, redonna toute son ardeur au grand rêve originel du sionisme.
L'holocauste avait aussi mobilisé comme jamais encore le soutien de la communauté juive de par le monde. Jusque-là, la majeure partie de la communauté juive mondiale ne s'était pas déclarée en faveur du sionisme, et s'y était parfois opposée. À l'inverse, la souscription des Arabes aux idées de l'Axe ne contribua guère à rendre la cause palestinienne populaire auprès de l'Occident. « L'opinion publique fut particulièrement influencée par le spectacle, qu’offraient les soldats britanniques empêchant les survivants de la Shoah d'atteindre les rivages de « la terre promise » et les renvoyant, même parfois en Allemagne. » (740)
Par la suite des troupes arabes se battirent pour un pays qui n'était pas à eux, alors que les leurs n'avaient jamais été menacés. En 1956 et 1967, les troupes égyptiennes se battirent pour un morceau de désert sans grand intérêt à leurs yeux. Donc « bien que la motivation jouât un rôle crucial dans certaines batailles, elle ne représente toutefois qu'un humble élément de l'histoire. » (743) Les choses changèrent en 1967, quand Nasser s’empêtra dans une guerre qu'il n'avait ni anticipée, ni préparée, entraînant avec lui tout le Moyen-Orient. La destruction des armées arabes fut totale et humiliante. Le monde arabe porta enfin son attention sur Israël, et commença à prendre l'idée de la guerre au sérieux. Mais à ce jeu-là, les Israéliens étaient mieux préparés et mieux outillés.
« Si on, se place à la fin des années 90, et que l'on se tourne vers le passé, l'histoire semble confirmer en substance les prédictions de Ben Gourion. En effet, l'un après l'autre, les pays arabes en sont venus admettre qu'Israël demeurerait et, à contrecœur, ont emprunté le chemin de la paix. » (746)
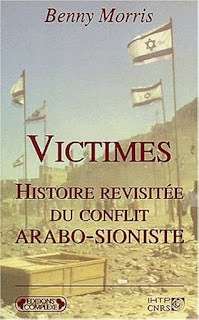



Commentaires
Enregistrer un commentaire