Paul Nizan : Antoine Bloyé
Paul Nizan, Antoine Bloyé, Grasset, 1933, 240 p. (epub)
Sous une forme romancée, l'auteur évoque la vie de son père de sa naissance à sa mort. Un récit en forme d’hommage pour cet homme ayant gravi marche après marche l'échelle sociale, et plus largement pour la condition ouvrière. Le récit commence par la veillée funèbre et s'attarde sur les objets, notamment la montre d'Antoine, puisque « les possessions des hommes, d'une manière plus dure que leurs possesseurs, poursuivent longtemps après eux leur destin ; leurs meubles leur survivent; leurs vêtements, leurs édifices, leurs pensées ne les accompagnent pas. » (19) C'est donc à partir de ce constat de la fragilité de la vie humaine, que le récit trouve sa légitimité : donner une éternité à cette vie ordinaire. Son père Jean-Pierre est employé du chemin de fer où il est facteur à la gare d'Orléans : un homme pauvre, attaché à une certaine place dans le monde. « une place décrétée pour la vie entière, une place qu'il mesure d'avance comme une chèvre attachée mesure l’aire ronde de sa corde. » (32) Mais enfant, Antoine ignore la condition difficile de ses parents. C'est l'époque des aventures, quelle que soit la condition des enfants, puisque « tous les petits humains sont d'abord semblables avant de laisser s'évanouir cette égalité naïve. » (41) Une sorte de fatalité pèse au-dessus de la vie, car, comme le dit la mère d'Antoine, « c'est la chance et les volontés de Dieu qui nous placent. » (49) Pourtant, Antoine pourrait douter que son père accepte les choses de la même façon, car, dans son silence, on pourrait penser qu'il réfléchit avec une sorte de colère triste. « Mais il n'est pas dans la coutume des hommes, que les fils pénètrent toutes les pensées qui se forment dans la tête des pères comme des grosses bulles douloureuses, et les fils ne sont pas des juges sans passions » (49) Et puis surtout, Antoine fait quelques études qui doivent l'amener vers un monde différent, un monde qui le séparerait de celui où, « depuis leur jeunesse ont vécu ses parents, il sent un commencement de séparation, il n'est plus exactement de leur sang et de leur condition, il souffre déjà comme d'un adieu, comme d'une infidélité sans retour. » (52) Des études qui l’amènent à Paris et à fréquenter d'autres milieux sociaux s'éloignant ainsi « des difficultés et des simplicités ouvrières, des décors de son enfance. (...) Certaines forces l'attiraient du côté de la bourgeoisie. D'autres forces cherchaient à ralentir son passage. » (73) Comme cette femme du peuple provocante « sûre du pouvoir irrésistible que lui donne l'ombre, l'humidité, le désert à peine peuplé par les fantômes que compose l'angoisse des hommes. » (74)
Antoine est dévoué à son métier, au milieu des siens, avant tout un milieu ouvrier; il est « un homme en série parmi eux » (97) Même s'il fait partie des chefs. En utilisant l'argot, il montre aux machinistes qu'il avait sous ses ordres. « qu'il était un homme du métier, qui connaissait les ficelles et qu'on ne trompait point. Ainsi, ces survivances de la jeunesse servaient-elles son commandement : tout conspire au succès des pouvoirs. Sa longue pratique des machines, sa connaissance des ouvriers qui les mènent donnaient à Antoine, une prise efficace sur les hommes : il leur faisait fournir leur plus haut rendement, il les entraînait dans sa propre action… » (100) Malgré son professionnalisme, un train est victime d'un déraillement. Antoine qui commandait et transmettait les commandements se voyait du même coup le complice de cet accident. Il « avait beau appeler à son secours des pensées de fonctionnaire, il savait bien qu'il était passé du côté des maîtres,. (…) Il pensait à son père, qui était de ceux qui subissent les ordres, aux camarades de son père, aux compagnons qu'il avait eu aux Chantiers de la Loire, et dans les corps de garde des dépôts, qui étaient aussi du côté des serviteurs, du côté de la vie sans espoir. » (105) Il se disait qu'il était un traître.
Il prenait aussi conscience que son travail l'absorbait tellement qu'il n'y avait pas de place pour autre chose. « Les hommes n'aiment pas, ni les femmes. C'est un ouvrage qui existe trop de patience, de présence, de fins communes, de communauté, d'amitié. Ils ont inventé les passions, les coups de foudre pour servir leurs lâches illusions. » (110) Il vécut aussi la mort de sa mère. « Des larmes coulaient jusqu'à la commissure de ses lèvres, et il les rattrapait machinalement avec sa langue. Il y avait peut-être 20 ans, 25 ans qu'il n'avait pas pleuré. Il s'y prenait mal, il ne s'abandonnait pas, il s'efforçait d'avaler cette boule qui montait et descendait en haut de sa poitrine, cette espèce de nausée. » Par rapport aux joies qui dilatent le thorax, « les hommes, malheureux tremblent comme les petits animaux qui se refroidissent rapidement, ils diminuent autant qu'ils peuvent la superficie de leur corps. » (117)
Mais, inexorablement la vie reprend le dessus avec la naissance de son fils : « un homme nouveau, expulsé de la chaleur et des liquides maternels, apprend à respirer dans la solitude des airs. » (162) La vie donc, ordinaire. Où chacun fantasme les vices et réussites des autres, notamment ceux qui sont placés plus haut. Il semble en effet aux gens d'en bas « que le mal croisse avec la richesse, le pouvoir : rien n’étonne de la part des « grands », car on pense qu'ils sont capables de tout, sont exposés à tout, dans leur monde démesuré de personnes tragiques et de héros oisifs : c'est l'univers d’Andromaque, d'Ajax, des Atrides. Et le destin irrité dirige ses coups contre ces êtres si recrus de plaisir, de fortune et d'orgueil : chaque scandale qui éclate, chaque drame, chaque décès, chaque ruine, confirme cette croyance naïve des petits bourgeois qui se veulent vertueux, laborieux et sages… Ainsi, les habitants des rues modestes se défendaient-ils contre la jalousie sociale, justifiaient-ils leur peu d’éclat : leurs indignations, leurs étonnement les vengeaient, ils se consolaient de cette manière-là de l'échec de leurs rêves de puissance, de vanité, de richesse : ils enseignaient à leur fils et à leurs filles, afin qu'ils n'eussent pas de visée trop haute pour leur condition, la sagesse du juste milieu, la modestie des violettes, la philosophie de l'honnête et de la médiocrité dorée. » (139)
Le milieu où Antoine se sentait le plus à son aise demeurait celui des ateliers dans lesquels il circulait comme un paysan parmi ses bêtes. Il s'attachait à certaines d'entre elles comme à des êtres vivants. Il était alors très loin des considérations de ces femmes de la moyenne bourgeoisie parlant avec hauteur des humbles et des ouvriers, en disant à leur propos qu'ils étaient ordinaires ou communs. C'est sa femme Anne qui lui racontait ces choses. Il se sentait alors envahi d'une certaine colère qui « n'était pas claire pour lui ». Ces insultes, il les prenait pour lui, pour son père, pour sa mère. « Comment prendre part à leur jugement sans être définitivement infidèle à sa propre enfance, à des hommes, à des femmes qu'il avait aimés ? Mais lui-même il était contre eux, ll les commandait de haut ? (152) Il n'était en effet plus du même côté. Ce dont il prenait conscience quand les ouvriers se mirent en grève et qui emportaient alors loin de lui « la force, l'amitié, l'espoir dont il était exclu. Il comprenait alors qu'il était un homme de la solitude, un homme sans communion. La vérité de la vie était du côté des hommes, qui regagnaient leur maison obscure, du côté des hommes qui n'avaient pas « réussi ». » (156) C'était une des leçons qu'il transmettait à son fils, celle aussi du travail bien fait dont on a le droit d'être fier, car « on peut l'élever devant soi comme une œuvre ». (160)
Peu à peu, en vieillissant, une sorte de désespoir s’empara de lui qu’il ne pouvait expliquer à personne. « Il était un homme sans vocabulaire et les mots lui auraient sans doute fait défaut. Il avait voulu décrire sa faillite et son dénuement. Cette angoisse ne pouvait pas être traduite, énoncée. » (208) Il se soigna avec des réunions d’anciens élèves, avec lesquels « des mots cordiaux fournissaient des déguisements. » (218) La vie prenait fin. C'est ce qu'il pouvait ressentir quand une fille de joie tentait de les attirer : « c'était une humiliation aussi terrible que la peur de la mort à leurs verges d'hommes impuissants, qui n'étaient plus entre leurs cuisses qu'un lambeau de chair, un passage de l'urine et non une source de puissance et de joie, une affirmation de l'homme. » (226)
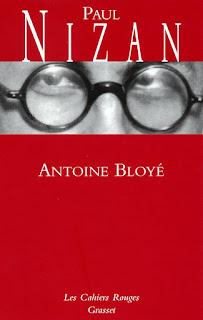



Commentaires
Enregistrer un commentaire