Les déterminants du vote en France observés sur la longue durée
Julia Cagé & Thomas Piketty, Une histoire du conflit politique. Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, Le Seuil, 2023, 857 p.
Introduction
Le vote pour le bloc central libéral–progressiste de 2022 apparaît comme l'un des plus bourgeois, observé depuis deux siècles, « dans des proportions inédites par rapport aux comparaisons de précédents historiques. » (19)
Les notions de gauche et droite remontent à la révolution française quand il s'agit de trancher la question du veto royal, la droite défendant dès lors le culte du chef. Cette séparation est inséparable d'un conflit de type socio-économique portant sur les questions des impôts et des taxes, des privilèges de la noblesse et du clergé, mais aussi du régime scolaire et plus généralement de la répartition de la propriété. La thèse défendue par André Siegfried est que là où la propriété terrienne est restée concentrée dans la main des grands propriétaires (nobles ou l’Église) avec notamment la mainmise sur l'école, les électeurs soutiennent les candidats monarchiques et conservateurs. Le vote post-révolutionnaire en leur faveur s'explique par la déception paysanne qui suit 1789, puisqu'ils n'ont pu accéder aux terres rachetables.
Pour expliquer le comportement politique des Français durant deux siècles, la notion de classe géosociale est centrale : elle inclut la question de la relation au territoire et aux ressources naturelles, aux moyens de transport, et aux sources d'énergie.
Le ressentiment des classes populaires après la révolution peut se différencier historiquement selon qu'elles ont eu affaire à des propriétaires ecclésiastiques dont les biens ont souvent été acquis par la bourgeoisie urbaine, ou à des propriétaires nobles.
Les révolutions politiques et industrielles ont donné lieu à plusieurs clivages politiques : entre centre et périphéries, entre l'État centralisé et les Églises, entre secteur agricole et industriel, entre propriétaires des moyens de production et travailleurs, auquel s'ajoutent aujourd'hui, le clivage migratoire et identitaire, le clivage autour de la mondialisation et de l'intégration économique, et le clivage autour de l'environnement et du réchauffement climatique
Première partie. Classes et territoires : les inégalités socio-spatiales en France depuis la Révolution.
La révolution française constitue l'acte de naissance de la démocratie électorale à l'échelle mondiale, puisqu'il s'agit de la première fois qu'un nombre aussi important de personnes (entre 5 et 7 millions) est appelé aux urnes de façon régulière et répétée. 30–40 % de participation à une époque où les moyens de transport sont rudimentaires. Participation plus forte dans les campagnes. Cette période révolutionnaire se manifeste par une « frénésie élective » (49). Mais le scrutin exclut les femmes et les hommes les plus pauvres (entre un quart et la moitié des hommes adultes).
Les régimes constitutionnels changent et à l'avènement du Sénat celui-ci devient un bastion : entre 1875 et 1940 il bloque de très nombreuses réformes sociales et fiscales. Il perd son droit de veto après la deuxième guerre mondiale.
La première assemblée nationale de juin 1789, compte 54 % de membres issus de la noblesse et du clergé, mais une proportion qui chute à 12 % après les législatives de juin 1791. On peut calculer qu'environ 70 % des parlementaires sont issus des 5–10 %, les individus les plus aisés de leur temps, ce qui persiste sous la IIIe, la IVe et la Ve République. La seule période où l'on observe une proportion significative d'ouvriers et d'employés se situe entre 1945 et 1980, mais pas plus de 10 % des élus.
La question de l'emprise de l'argent n'est pas secondaire, puisqu’actuellement un don politique ouvre droit à une réduction d'impôt, ce qui revient à faire subventionner aux deux tiers les préférences politiques des plus riches par le reste des contribuables (66).
Au moment de la Révolution, les 10 % les plus fortunés, détenaient à eux seuls autour de 85 % du total des propriétés, et les 1 % les plus riches possèdent 55 % en France, 65 % à Paris. Cette part tombe à partir de la Première Guerre mondiale pour représenter 50 % dans les années 80 avant de repartir à la hausse depuis (55 % en 2020). Cette déconcentration sur longue période s'est faite au bénéfice des 40 % suivant et non des 50 % les plus pauvres. L'écart de patrimoine entre les deux extrémités est de 1 à 50 : 10 % possèdent 55 % soit 10 fois plus que les 50 % les plus pauvres. La Révolution a donc eu des effets limités. Mais comme sous l'ancien régime l’Église était de loin le premier propriétaire du royaume, la grande transformation résulte de l'accaparement bourgeois de ses propriétés. Cette forte concentration va s'accentuer jusqu'en 1914, avec les nouvelles possibilités d'accumulation dues à l'industrialisation, les placements financiers et l'empire colonial.
On constate d'une manière générale que la concentration des revenus est toujours moins extrême que celle des patrimoines. Si on observe une réduction des inégalités entre 1910 et 1990, c'est dû à l'avènement de l'État social qui apparaît dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale. Auquel s'ajoute la croissance des revenus salariaux : entre 1968 et 1983, le pouvoir d'achat du salaire minimum progresse de 130 % contre environ 50 % pour le salaire moyen.
Du point de vue du territoire, l'élément le plus important est la polarisation croissante de la population sur certaines zones : 20 départements rassemblaient 35 % de la population en 1800 et 47 % aujourd'hui. Hausse qui s'explique notamment par celle de l'Île-de-France, qui passe de 5 % à 19 %. De l'autre côté, il existe 16 départements qui connaissent une baisse absolue de leur population dont 6 avec une chute de plus de 30 % (Cantal, creuse, Lozère, lotte, Meuse et Orne). À l'échelle de la commune, on retrouve le même phénomène : 10 % des communes ayant la plus forte population rassemblaient 42 % de la population en 1800 et aujourd'hui 70 %. La répartition dans des grandes agglomérations s'est stabilisée au milieu des années 70 et depuis toutes progressent au même rythme.
Du point de vue de la richesse, on constate une remontée des écarts de PIB par habitant entre les cinq départements les plus riches et les cinq les plus pauvres, qui s'explique par la concentration de la richesse en Île-de-France : alors que les départements les plus prospères étaient répartis de façon équilibrée sur l'ensemble du territoire à la fin du XIXe siècle et la majeure partie du 20e, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui (en 1860 : Paris, la Seine-Maritime, la Marne, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône). Pour mesurer les inégalités socio-économiques, il existe deux indicateurs : le revenu et le capital immobilier, ce dernier est intéressant car il y a des sources complètes sur une longue période. Ainsi, le ratio de celui-ci entre les cinq départements les plus riches et les cinq départements les plus pauvres est passé de 8 en 1800 à 9,5 en 1900, 2,8 en 1985 et 5,4 en 2022.
Depuis 1980–90, on observe une détérioration des banlieues pauvres et des métropoles pauvres ainsi qu'une stagnation des bourgs pauvres si bien qu'au final toutes ces catégories se retrouvent au même niveau que les villages pauvres dans les années 2010 et au début des années 2020 avec un revenu autour de 80 % de la moyenne nationale. Ceci est frappant alors que les comportements politiques de ces territoires ont « profondément divergé au cours des dernières décennies. » (122) Ces différences de revenu ne tiennent pas compte des différences de coût de la vie et notamment du coût du logement et donc pour un même revenu il existe des différences considérables de conditions de vie : il existe beaucoup plus de propriétaires de leur logement dans les bourgs, villages, puis les banlieues et enfin les métropoles. La géographie de la proportion de propriétaires ne coïncide que très imparfaitement avec celle du revenu ou du capital immobilier par habitant.
Les propriétaires sont passés de 37 à 58 % entre 1960 et 2022. Et sont associés à cette croissance des efforts d'épargne et de stabilité professionnelle ou personnelle, et donc des valeurs et des identités spécifiques.
La répartition des professions sur le territoire est aussi intéressante : les ouvriers et les employés sont présents partout sur le territoire, y compris dans les villages où historiquement, ils étaient plutôt absents. « Le monde des villages et des bourgs autrefois agricole et indépendant, est ainsi largement devenu ouvrier et employé. » (132) On observe donc des spécialisations territoriales, avec une plus grande importance du commerce, de la restauration et des services sociaux et éducatifs dans les métropoles et banlieues, alors que dans les bourgs et villages on voit le développement de l'industrie et de l’agroalimentaire et donc une sensibilité plus grande aux questions de concurrence internationale et de délocalisation.
Même façon, l'éducation a connu de profonds changements puisque les ressources publiques consacrées étaient à peine de 0,5 % en 1900 et 6 % en 1980. L'instruction peut être mesurée par exemple avec la signature de l'acte de mariage qui est passé en France de 23 % en 1886 à 37 % en 1786, 72 % en 1870 et 97 % en 1905. Lors du recensement de 1866 à peine 55 % de la population de 20 ans et plus est enregistrée comme sachant écrire, ces proportions dépassant les 90 % à partir des années 1920. À la fin du 18e comme du 19e les territoires situés au nord-est de la ligne Saint-Malo/Genève sont en moyenne plus alphabétisés que ceux du Sud-Ouest. Si on regarde la géographie des diplômés du supérieur en 2022, on constate comme pour la richesse économique, une répartition très différente avec un retournement complet de la ligne initiale puisque l'Ouest et le sud-ouest dépasse les régions traditionnellement alphabétisées et industrielles du nord-est. En 2022, la proportion des diplômés de l'enseignement supérieure s'approche des 60 % dans les métropoles riches, alors qu'elle est à peine de 20 % dans les pauvres et villages pauvres. Pour l'éducation comme pour le revenu et le capital immobilier ce sont avant tous les inégalités à l'intérieur de chaque catégorie spatiale qui ont eu tendance à s'élargir, Les banlieues, pauvres restant au-dessus des bourgs et des villages pauvres pour ce qui concerne les diplômes du fait d'une plus grande proximité des grands établissements universitaires.
En 1794, la Convention prévoyait une rémunération des instituteurs par l'État, mais le projet est abandonné dès 1795 et donc la charge financière retombe sur les familles, les communes et l’Église. Celle-ci reçoit de la part de l'État un budget des cultes visant à compenser la perte de ses biens et de la dîme. Ainsi au XIXe siècle, elle retrouve une sorte de plénitude morale et politique en s'investissant dans les questions d'éducation, notamment des filles. En 1908. Le décret napoléonien précise que toutes les écoles « prendront pour base de leur enseignement, les préceptes de la religion catholique. » (157) Au début des années 1870, la proportion d'enfants scolarisés dans les écoles primaires publiques laïques avoisine les 50 % : 70 % pour les garçons, mais seulement 30 % pour les filles. La gratuité et la scolarité obligatoire jusqu'à 13 ans sont instituées par les lois de Jules Ferry. Et la loi décide que les enseignements religieux se feront en dehors des écoles publiques. Une revendication catholique émerge à la fin du XIXe siècle, de ne pas payer deux fois : par les impôts pour financer les écoles laïques, puis de nouveau pour financer les écoles de leurs enfants, revendication qui joue un rôle structurant pour souder les droites dans les décennies suivantes. Notre choc est la suppression du budget des cultes lors de la loi de séparation de 1905. Avec ces lois successives, la part du public augmente dans le primaire et à retardement dans le secondaire (après la deuxième guerre mondiale). Secondaire qui reste longtemps une affaire de garçons, car les filles représentent à peine plus de 1 % des effectifs, des collèges et des lycées en 1880, un tiers en 1930, la moitié depuis 1960. L'enseignement privé voit ses effectifs se stabiliser avec la loi de 1959 qui légifère avec la notion d'établissement sous contrat : celui-ci prévoit les mêmes programmes dans les deux écoles, même si le privé peut choisir ses propres élèves et continuer de faire payer les familles. Le comité national d'action laïque proteste contre cette concurrence déloyale avec une pétition de 11 millions de signataires en 1960, mais rien n'y fait. La loi Guermeur de 1977 complète, la loi de Debré en renforçant les pouvoirs du chef d'établissement pour choisir ses enseignants. La réforme envisagée en 1984 d'un grand service public unifié de éducation ne voit pas le jour à cause de la mobilisation des parents d'élèves du privé. La part du privé se stabilise autour de 14 % dans le primaire et de 20 % dans le secondaire, avec toutefois une hausse tendancielle récemment plus particulièrement dans les territoires les plus riches.
Le vote des catholiques a été ausculté par Guy Michelat et Michel Simon, qui montre notamment qu'ils ont une peur absolue du communisme, car il nie la famille, la petite propriété, l'individu, les mères au foyer, etc. De fait on observe une corrélation positive entre la pratique religieuse, le niveau de patrimoine, le revenu et le vote à droite. Mais que ce soit la fin du 19e ou aujourd'hui, l'enseignement privé est sur-représenté dans les métropoles et dans les bourgs, alors qu'il est peu présent dans les villages comme dans les banlieues. La très forte ségrégation sociale, observée au niveau des collèges de la capitale, s'explique pour moitié par la ségrégation résidentielle et pour moitié par le recours privé. (176)
La question des origines joue peu par rapport aux variables socio-économiques. La part de la population étrangère est passée de 1,1 % en 1851 à 6,6 % 1931 et 7,4 % en 2022. La part des catholiques est passée entre 1820 et 2022 de 98 % à 50 % de la population, les sans religion de 0,1 à 39 %, les musulmans de 0,1 à 8 %, les autres religions, restant stables autour de 2-3 %.
La part des étrangers dans les banlieues riches oscille entre 6 et 8 % entre 1960 et 2022 alors qu'elle est passée de 7 à 14 % dans les banlieues pauvres, mais c'est la répartition inverse dans les métropoles où les riches sont plus dotés que les pauvres en étrangers. Les étrangers européens sont surreprésentés dans les métropoles riches. Alors qu'au contraire les Européens le sont dans les banlieues pauvres.
Pour ce qui est du métissage, on constate que les unions mixtes sont de plus en plus nombreuses : seuls 9 % ont quatre grands-parents immigrés, 38 % deux grands-parents et 48 % un seul. Les catégories américaines de type blanc/noir ne pourrait pas être appliquées en France.
Par ailleurs, les écarts budgétaires entre les communes sont considérables et peu compatible avec des discours sur l'égalité des droits et des chances. A cela, s'ajoutent les effets de discrimination avec une naturalisation qui s'obtient au bout de quatre ans au lieu de deux et les logements sociaux en nombre insuffisant dans les bourgs et villages
Deuxième partie. Essor et déclin de la mobilisation démocratique : la participation électorale en France, 1789‑2022.
Quel que soit le scrutin considéré, la participation rurale est toujours plus élevée alors qu'il est plus difficile pour les ruraux d'aller au bureau de vote. L'alphabétisation ne semble pas être le facteur majeur permettant d'expliquer la mobilisation électorale. On passe d'une participation de 30–40 % dans les années 1790 à 70–80 % à partir de 1848, indiquant le long processus de mobilisation collective et d'émergence d'une culture politique. L'abstention ne concerne pas toujours les mêmes personnes : une étude portant sur les scrutins de 1978 à 1992, montre que 1–2 % des électeurs inscrits s'abstiennent de façon systématique. La chute récente de participation constatée aussi au Royaume-Uni et en Allemagne n'est pas universelle, puisque par exemple aux États-Unis c'est l'inverse.
Le taux d'inscription est généralement plus élevé dans les petites communes que dans les grosses et c'est la seule variable à avoir un impact clair sur le taux d'inscription (ni le diplôme ni le niveau de richesse ne possèdent cet impact sauf dans les scrutins très récents).
De 1848 à 2022, la participation baisse, mais au sein d'une même circonscription électorale, les communes les plus aisées participant davantage peuvent faire basculer le scrutin du côté de leurs préférences. En particulier, on constate une chute forte de la participation au sein des communes les plus ouvrières qui se caractérisaient pendant deux siècles par une participation électorale élevée. C'est un effondrement inédit à partir de la fin des années 1990, et surtout dans les années 2000 et 2010. La présence d'une population d'origine étrangère a aussi eu un impact négatif sur la participation au cours des deux dernières décennies, alors que ce fait n'existait pas auparavant.
Il est possible de mesurer la part des variations, observées de la participation dues à des variables socio-démographiques (taille d'agglomération, âge, sexe, revenu, capital immobilier, diplôme, profession, etc.) : cette part est passée de 30 % en 1848 à 70 % 2022 et les variables les plus importantes sont la taille d'agglomération, le revenu et le capital immobilier qui expliquent entre la moitié et les trois quarts du pouvoir explicatif total (291). Au fil du temps, il y a donc un déclin relatif des facteurs géographiques à cause du développement des moyens de transport et de communication et à la nationalisation des campagnes électorales.
La participation aux campagnes présidentielles montre que les communes pauvres votaient autant ou davantage que les riches en 74, 81, 88, 95 et depuis 2002, c'est l'inverse. Comme précédemment, les variables socio-démographiques s'imposent dans l'explication de la participation aux scrutins présidentiels, passant de 30 % à plus de 70 %. On observe aussi un grand différentiel de participation entre la présidentielle et les législatives. Une solution pourrait être d'organiser un scrutin simultané qui permettrait peut-être de tirer l'ensemble des participations vers le haut en obligeant les candidats à préciser davantage le contenu de leur programme législatif et les contours de leurs majorités parlementaires.
Pour les référendums, on voit que celui de 1793 qui portait sur l'instauration d'une constitution abolissant la monarchie et instituant le suffrage masculin universel et l'élection directe de députés est avant tout un vote rural et anti-nobiliaire, puisque c'est là où la concentration des terres agricoles est la plus forte que la mobilisation est la plus grande. À l'inverse, en 1795, la nouvelle constitution visant à priver de droit de vote une partie des électeurs les plus pauvres, la participation des paysans pauvres est la plus faible. Avec des spécificités locales, puisque dans l'Ouest, la concentration foncière est associée à votre monarchiste ou conservateur (André Siegfried pour les élections de 1871 à 1910).
On constate aussi une diminution très nette de l'importance, des déterminants religieux au cours des deux siècles.
Troisième partie. Entre bipolarisation et tripartition : deux siècles d’élections législatives en France
Le vote oscille entre ces deux pôles : quand le clivage lié à la richesse, l'emporte sur le clivage rural/urbain, les territoires les plus populaires du monde rural et du monde urbain se rapprochent politiquement et tendent à voter ensemble pour la gauche. Et donc le système est alors bipolaire (1910–1992). À l'inverse quand le clivage rural/urbain est plus fort que celui lié à la richesse alors c'est la tripartition qui prévaut avec un bloc central jouant un rôle autonome.
Certains classent les périodes successives structurant la confrontation politique depuis la Révolution en périodes où prime la question institutionnelle (1789–1900) puis la question sociale (1900–1990), et enfin la question nationale depuis 1990).
La tripartition émerge au milieu du XIXe siècle. En mai 1849, les conservateurs arrivent en tête, mais les modérés baissent à 18 % avec le très impopulaire général Cavaignac, quand les démocrates-socialistes font 35 %. La peur s'empare du bloc des conservateurs, d'autant plus que les élections partielles conduisent à de nouvelles victoires de la gauche, non seulement au sein du prolétariat urbain, mais également dans plusieurs territoires ruraux, ce qui sème la terreur parmi les grands propriétaires terriens. Cela conduit le parti de l'Ordre à restreindre le droit de vote avec la loi de mai 1850, séquence qui se conclut par le coup d'Etat de décembre 1851. La tripartition est donc un système instable.
« Au total, sur l'ensemble de la période, 1848–2022, on constate avec les classifications retenues que la gauche obtient en moyenne 41 % des suffrages exprimés, contre 14 % pour le centre et 45 % pour la droite. » (374) Mais une autre construction donnerait 48 % pour la gauche et 52 % pour la droite sur la même période. Le terme de droite ayant été en partie banni du vocabulaire, car historiquement associé à la défense du régime monarchique, puis à celui de Vichy. Les partis de droite font leurs plus gros scores dans le monde rural, alors que pour la gauche c'est dans le monde urbain. En particulier, c'est la relation à l'agriculture et à la propriété foncière agricole qui lie la droite aux aspirations des indépendants. Mais leur place décline massivement au cours du XXe siècle, alors que le vote rural à droite se maintient.
Les communes les plus ouvrières ne sont pas nécessairement les plus pauvres, car elles correspondent à des lieux de développement industriel où se concentre la production de richesses nouvelles lesquelles bénéficient d'abord aux ingénieurs, aux dirigeants et aux actionnaires. Le vote ouvrier peut s'expliquer par cet écart. À la fin du XXe siècle, ces lieux sont associés à la désindustrialisation, à la pauvreté et au chômage. Les productions de richesse se concentrent dans les services et dans de nouveaux territoires au sein des métropoles et banlieue aisées. Il y a pertes de revenus dans les anciennes communes ouvrières.
On observe que quand le clivage lié à la richesse l'emporte sur le clivage rural/urbain, alors les territoires les plus populaires du monde rural et du monde urbain se rapprochent et tendent à voter pour la gauche. À l'inverse quand le clivage rural/urbain est plus fort comme au XIXe siècle, on observe une victoire de la tripartition. Mais les périodes sont très différentes par rapport à cette tripartition, du point de vue de la question de l'accès à la propriété, aux services publics et aux transferts sociaux.
En définitive, les résultats s'inscrivent en faux contre l'idée d'une ethnicisation du conflit politique et d'une inexorable montée en puissance du clivage communautaire. Le rôle de la classe géosociale est le plus important.
Si Napoléon l'emporte en 1848, c'est parce qu'il s'est prononcé contre certaines hausses (et 0,45 €) que les républicains voudraient mettre en œuvre. Même si les courants les plus à gauche dénoncent cette ponction fiscale injuste et prônent une réforme fiscale ambitieuse fondée sur la création d'un système d'un progressif sur le revenu, les successions et la fortune, ils sont associés à la charge fiscale prévue par les autres républicains. Ils ne réussissent pas à se faire entendre des populations rurales, ainsi que le montre la lecture des quotidiens républicains parisiens lesquels n'abordent jamais les questions liées au monde rural alors qu'il est plus peuplé que le monde urbain.
Proudhon, député socialiste, propose une réforme fiscale qui est retoquée par l'Assemblée qui déclare : « cette proposition est une atteinte odieuse au principe de la morale publique ; elle viole la propriété ; elle encourage la délation ; elle fait appel aux mauvaises passions. » Proudhon sera démis de ses fonctions parlementaires, puis écroué pour avoir participé à l'insurrection de juin. L'État est bien au service des possédants comme par exemple quand il compense financièrement les propriétaires d'esclaves après l'abolition, ce qui accroît la dette publique et ce qui sera ensuite utilisé par le pouvoir pour légitimer des augmentations d'impôt sur la masse de la population.
Cependant, au début du XXe siècle, un taux d'imposition assez faible est établi. C'est une brèche qui conduira à des augmentations importantes dans les années suivantes avec des taxations très hautes entre les deux guerres et donc une déconcentration du patrimoine. Cette nouvelle philosophie s'inspire notamment du solidarisme porté par Léon bourgeois et Émile Durkheim, selon laquelle les créations de richesse dépendent de la division du travail social, et donc l'accumulation ne devrait pas être appropriée par quiconque. Dans la continuité, les radicaux socialistes et socialistes adoptent en 1910 une loi sur les retraites ouvrières et paysannes qui est financée par une augmentation de l'impôt successoral (à 6,5 %) : ce sont donc les hauts patrimoines qui contribuent au financement de mesures sociales. Dans le même état d'esprit, le financement par le budget de l'État des écoles publiques communales devient le symbole le plus fort et le plus visible de ces nouveaux services publics universels bénéficiant autant aux villages qu'aux métropoles ; de la même façon avec le développement des infrastructures de transport.
Une Assemblée dans laquelle certaines classes sociales perdent de leur poids : en 1871, il y avait 225 députés nobles (un tiers des sièges). Cette proportion chute à moins de 10 % en 1914 et moins de 5 % dans l'entre-deux-guerres.
On observe une proximité entre la droite et le centre sur les questions économiques et financières avec l'opposition à l'impôt sur le revenu par exemple, ou l'accord sur les questions coloniales. (Ernest Renan, déclare : « La colonisation en grand est une nécessité politique tout à fait de premier ordre. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche et du pauvre »). Le désaccord sur la question du régime perd de son acuité avec le ralliement de la droite à la République ouvrant ainsi la voie à une fusion du centre et de la droite, d'autant plus urgente avec la montée en puissance des radicaux socialistes et des socialistes ayant comme base une plate-forme redistributive.
Toutes les enquêtes qui possèdent des informations sur le patrimoine des électeurs, montrent que ceux qui détiennent un patrimoine important vote rarement pour la gauche et à l'inverse, ceux qui n'ont aucun patrimoine se reconnaissent rarement dans la droite. De même entre 1910 et 1993, on observe une régularité entre le vote à gauche et la proportion d'ouvriers, que l'on introduise ou non les autres variables explicatives, ou encore que le vote à gauche décline graduellement avec la proportion d'indépendants dans la commune. Ainsi, la bipartition politique « a toujours été incomplète et fragile dans la mesure où la gauche a toujours eu du mal à rassembler pour un même niveau de richesse les personnes ayant des statuts différents face à l'emploi et l'activité économique. » (495) C'est quand d'une part, les radicaux socialistes plus proches des petits propriétaires et des indépendants modestes, d'autre part les socialistes proches du prolétariat urbain se sont rapprochés, ils ont réussi leurs meilleurs scores aux élections législatives (1910, 1914). Dans la période où les radicaux rassemblent 15 à 20 % des voix, le bloc central est trop faible pour constituer une majorité autour de lui et en même temps trop fort pour que les blocs de gauche et de droite puissent gouverner sans lui. Quand, après la Première Guerre mondiale, qui a vu des destructions sans commune mesure avec ce qu’on avait connu auparavant, la dette publique atteint un niveau considérable inconnu depuis la révolution française, la question du paiement de cette dette est une épreuve pour tous et qui pose la question de la répartition de l’effort entre les classes sociales. Les idéologies du socialisme, du libéralisme et du nationalisme entrent en crise. Si en principe le bloc de droite est en faveur du libéralisme économique, les faillites en cascade et le chômage de masse montrent la fragilité du capitalisme et donc de nouvelles formes d'interventionnisme étatique sont envisagées dans tous les bords politiques (New Deal aux États-Unis, nationalisation et planification en France après 45). L'ironie veut d'ailleurs que ce soit l'une des chambres parlementaires les plus à droite (la chambre bleu horizon de 1919) qui met en place l'impôt progressif sur les très haut revenus.
Après 1945, la SFIO préfère toujours gouverner avec le MRP et le centre droit plutôt qu'avec le PCF, c'est ainsi qu'elle peut s'allier avec les Britanniques pour entreprendre une expédition militaire en Égypte, pour récupérer le canal de Suez, et donc jouer au colonialiste défendant les intérêts capitalistes alors que son chef (Guy Mollet) se dit marxiste. Dans le même temps, le PCF soutient la répression soviétique en Hongrie et la SFIO conduit la répression en Algérie : tout cela exacerbe l'antagonisme entre les deux partis de la gauche. Ces désaccords de fond ne s'observent pas du point de vue de la sociologie de leurs électorats.
Les deux partis sont proches des salariés, mais plus éloignés des indépendants, comme peut en attester la loi sur la sécurité sociale ou le système des impôts qui cherche à surveiller les indépendants dont on soupçonne qu'ils sous déclarent leurs revenus.
Le parti socialiste occupe le pouvoir durant 20 ans entre 1980–2020, ce qu'on observe chez aucun voisin européen.
On peut dater le retour de la tripartition au moment du traité de Maastricht en 1992, qui voit les électeurs du centre gauche et du centre droit adhérer aux mêmes positions. À l'inverse ce référendum comme celui de 2005 voient le camp du non alimenté par deux forces irréconciliables et incapables de gouverner ensemble, une issue de la gauche, l'autre de la droite nationale.
Les autres enjeux contribuant à l'émergence de la tripartition sont des enjeux migratoires et identitaires, et plus généralement l'importance croissante de la question nationale et des questions liées à l'intégration économique et commerciale à l'échelle européenne et mondiale. Et ce sont ces dernières questions fondant de nouvelles inégalités territoriales qui expliquent en dernier ressort les tendances du vote récentes.
Il est frappant de constater à quel point le profil de vote à gauche en fonction du revenu communal est stable dans le temps : au moins il y a de populations riches dans la commune, plus le vote à gauche est fort. Mais une transformation s'opère, puisque le vote de gauche est moins associé au vote ouvrier et de plus en plus à celui des employés, des femmes et des jeunes. De plus, il y a un effet négatif du nombre de cadres dans la commune sur le vote à gauche, mais cet effet est réduit lorsque l'on contrôle avec le niveau de richesse.
Notons que dans tous les pays où il existe des enquêtes similaires, on constate qu'après avoir largement voté pour la droite dans les années 50 et 60, les femmes depuis des années 90 votent plus à gauche que les hommes.
Pour un revenu et un patrimoine donnés, les gens les plus diplômés tendent à voter davantage pour la gauche, ce qui est un retournement qu'on observe dans d'autres pays. On pourrait dire qu'une opposition entre une droite marchande (les électeurs les plus riches) et une gauche brahmane (les électeurs les plus diplômés) voit le jour, en précisant que ce sont les diplômés occupant les professions les moins bien rémunérées.
Si l'on observe le vote en fonction de la présence d'étrangers dans les communes, on voit sur le long terme que celles ayant la plus forte proportion votent à gauche, même si cet effet est plus faible après la prise en compte des contrôles socio-démographiques.
Si on retrouve le clivage rural/urbain entre la droite et la gauche qu'on n'avait plus connu depuis la fin du XIXe siècle c'est en grande partie à cause du vote d'extrême droite car le parti LR est tiraillé entre le bloc national–patriote et le bloc libéral–progressiste. Le profil de vote pour le Front National a lui-même, évolué : en 1986–88, il est urbain et dans les communes à plus forte proportion d'étrangers. À partir de 1990, il déplace son discours sur la dénonciation de l'intégration économique européenne et est de moins en moins relié à la présence étrangère « à tel point que la relation disparaît presque complètement en 2017–2022. » (583) Ce qui se manifeste sans doute, c'est un sentiment général d'abandon dans les bourg et les villages. Et, les immigrés constituent une figure repoussoir sur laquelle est reporté ce qui est vécu comme une chute de statut. Si le FN rassemble un vote ouvrier, il n'atteint jamais l'ampleur massive observée pour le vote du PCF concentré dans les banlieues ouvrières, alors que le vote FN est un vote d'ouvriers ruraux et périurbains, les ouvriers travaillant dans des installations industrielles ou des centres logistiques localisés loin des métropoles. Une autre caractéristique du vote FN est la corrélation avec la proportion d'indépendants dans la commune. Par ailleurs, la gauche et le FN ont des points communs : vote croissant avec une proportion d'employés et décroissant avec la proportion de cadres.
Ce qui distingue ces deux orientations opposées, c'est la relation au diplôme d'une part et à la propriété d'autre part, gauche d'un côté, FN de l'autre. « Le vote FN croit régulièrement avec la proportion de propriétaires dans la commune. À l'inverse, la relation est négative concernant le vote de gauche. » (590) Ces petits–moyen s'identifient à un parti qui soutient leur trajectoire originale de promotion sociale, ne passant ni par les diplômes, ni par les syndicats, ce qu'a bien compris le parti qui propose que chaque famille pourrait bénéficier d'un prêt de 100 000 € sans intérêt pour l'accès à la propriété, et ce prêt ne serait plus remboursé à partir de la naissance du troisième enfant. Ce point est d'autant plus important que la participation électorale a beaucoup moins fortement chuté dans les communes comprenant la plus forte propension de propriétaires.
« Aujourd'hui comme hier, le nationalisme se présente comme une tentative consistant à valoriser avant tous les solidarités nationales et ethno-raciales afin d’éviter la lutte des classes. (597)
Quatrième partie. Entre démocratie représentative et démocratie directe : les clivages politiques dans les scrutins présidentiels et référendaires.
Louis-Napoléon Bonaparte, qui recueille une très grosse majorité des suffrages en 1848 (75 %.), a su stigmatiser l'hypocrisie et l'égoïsme des élites parlementaires, promettre le vote au niveau de la commune ou la fin des remplacement au service militaire, critiquer le milliard des immigrés et rappeler son opposition absolue aux privilèges aristocratiques et féodaux et sa foi dans le développement industriel et la hausse des salaires ouvriers. (624) Ulcéré par le refus de l'Assemblée de procéder à une révision constitutionnelle lui permettant de se représenter en 1852, il organise un coup d'Etat et s'appuie sur une série de plébiscites pour introduire un régime autoritaire et se faire proclamer empereur héréditaire, mettant ainsi fin au pluralisme électoral. « Cette expérience désastreuse a convaincu les contemporains de la nocivité du présidentialisme et explique les réticences à réintroduire un tel système en France pendant plus d'un siècle. (625)
Le retour de cette élection en 1965, montre que le vote des communes riches pour De Gaulle est à peine supérieur à la moyenne, alors qu'il est deux fois plus élevé pour Lecanuet : « une partie importante des élites de droite traditionnelle ont encore des réticences face à De Gaulle et ses tendance au césarisme. » (631)
Il faut noter que le vote Tixier–Vignancour est fortement croissant avec la richesse, comme le sera plus tard, celui pour Éric Zemmour.
Entre 1965 et 1995, les écarts entre territoires ne sont pas très importants parmi les principaux candidats, c'est le clivage dans de classe qui prévaut.
En 1981, c'est Chirac qui présente le profil le plus marqué vis-à-vis de la richesse, sans doute à cause de son discours, dénonçant la mollesse et les compromissions du pouvoir giscardien.
Le discours de la droite est d'ailleurs alambiqué sur la question du libéralisme : en 1995, après avoir fait campagne autour de la résorption de la fracture sociale, Chirac et Jupé, décrètent dès le mois de juillet, une hausse de 2 points de la TVA. Et en 2002, Jospin ne se qualifie pas malgré les 35 heures, sans doute parce qu'elles bénéficient plus aux cadres qu'aux employés et ouvriers qui font face à une flexibilité forcée et auraient préféré davantage de pouvoir d'achat.
En 2007, Sarkozy siphonne l'électorat de Le Pen qui passe de 17 à 11 %. Mais c'est précisément à cette date qu'apparaît pour la première fois un profil de vote FN caractérisé par un score maximal dans les villages suivi des bourgs.
De la même façon, si les rapatriés jouent un rôle significatif lors de l'éclosion du FN, ce rôle devient secondaire au moment où ce parti a atteint ses scores les plus élevés. Selon certains travaux, les rapatriés représentaient jusqu'à un quart des individus se présentant comme militants ou sympathisants du FN).
Du côté du vote écologiste, les candidats réalisent des scores plus élevés dans les métropoles et les banlieues, et dans les communes où le revenu moyen s'accroît.
Le vote pour lutte ouvrière est plus élevé au sein des villages et des bourgs et il est décroissant (comme à la LCR ou au NPA) avec la richesse de la commune.
L'échec de Lionel Jospin, en 2002 s'explique par le tournant de la gauche qui fait de la baisse générale de l'impôt sur le revenu, une priorité y compris pour les revenus les plus élevés alors qu'il existe dans la santé et l'éducation d'immenses besoins non satisfaits. Laurent Fabius déclare ainsi : « la gauche ne court pas beaucoup de risque d'être battue par la droite, mais elle peut l'être par les impôts et les charges. »
C'est à partir de cette date qu'on observe le divorce entre les catégories populaires et les urnes. Et c'est aussi à ce moment-là (2007) que François Bayrou refuse d'appeler à voter pour Sarkozy au second tour, ce qui traduit une volonté d'autonomie du centre : il est parvenu à attirer des électeurs du centre gauche séduits par un social-libéralisme modéré et européen: 49 % de ses électeurs votent Royal au second tour et 39 % Sarkozy.
L'opinion publique commence à se méfier de l'Europe avec cette logique fondée sur la socialisation des pertes et la privatisation des profits après les crise successives de 2008 ou 2020. On se demande pourquoi les milliardaires ne sont pas plus mis à contribution pour payer l'addition et pourquoi les autorités publiques ne se mobilisent pas autant pour le climat, la santé ou l'éducation que pour sauver les banques et les banquiers.
Le vote Macron se rapproche plus du vote Sarkozy, que de celui pour De Gaulle, Giscard ou Chirac : il fait des scores plus faibles que ces prédécesseurs dans les communes pauvres en particulier dans le monde rural.
D'une manière générale, la classe géosociale (niveau de richesse, taille d'agglomération, explique lors des derniers scrutins 60 % des écarts de vote au niveau communal contre environ 20 % en 1848 et 30–40 % dans les années 1970.
Les classes aisées sont européennes ce qui les écartent du vote pour le Vicomte, Philippe de Villiers, et lui accordent en 1995 un score à peine plus fort que son résultat au niveau national.
Les référendums de 1992 et 2005 montrent la fragilisation du clivage gauche/droite et la montée en puissance de la tripartition avec un bloc central soutenant l'Europe libérale et deux blocs latéraux la contestant. Ces deux référendums marquent aussi l'entrée symbolique de l'histoire politique française dans l'âge de la mondialisation. Avant cela, il y a eu d'autres référendums. Les débats constitutionnels de 1945–1946 marquent la fin du droit de veto qu'avait le Sénat qui ainsi a pu bloquer des réformes comme l'impôt sur le revenu au début du XXe siècle, ou le droit de vote des femmes, réforme adoptée par l'Assemblée, mais refusée par le Sénat. L'Assemblée constituante de 1945, dominée par les communistes et les socialistes propose donc une constitution monocamérale. Ce que contestent toute la droite française ainsi que les hiérarchie catholique qui appellent à voter contre cette proposition : le non l'emporte de justesse. Une seconde assemblée constituante élue en juin 46 pour élaborer un nouveau projet. Si désormais le Sénat garde sa place, il perd son droit de veto.
Le référendum de 2005, sur le traité constitutionnel européen donne à ses décisions, « un caractère éternel et irréversible, indépendamment de toute évaluation collective ou d'élaboration démocratique. » (793) Par rapport à 1992, le contexte est dégradé avec la destruction d'emplois industriels et de délocalisations au profit de pays à bas coûts, et c'est dans ce contexte que le non l'emporte. Et ce sont les communes pauvres qui votent plus fortement pour le non avec des écarts amplifiés par rapport à 1992. Mais ce n'est pas simplement la richesse qui détermine le vote. C'est aussi par le fait que les ouvriers se perçoivent comme plus directement menacés que les employés par la libéralisation commerciale, car leurs emplois sont plus facilement délocalisables. Ce scrutin illustre la déception vis-à-vis de la gauche dans ce processus de mondialisation. Si la mobilité des biens et des personnes (Erasmus) traduit une ouverture croissante aux autres pays semblants en accord avec les valeurs internationalistes de la gauche, en revanche, cette ouverture au commerce international vantée par les socialistes car susceptible de réduire les prix et d'améliorer le pouvoir d'achat se traduit aussi par des délocalisations et des destructions d'emploi. « Pour les personnes concernées, la perte de revenus et de dignité est alors autrement plus importante que le fait de pouvoir accéder à des grandes surfaces avec des prix plus faibles. » (805) D'autre part, la concurrence accrue, tous les gouvernements mènent des politiques fiscales et sociales plus favorables aux acteurs les plus mobiles (cadres, grandes entreprises ou détenteurs de revenus et de patrimoines élevés). Et c'est ce qui s'est passé. À la fin des années 70, le taux d'impôt sur le bénéfice des sociétés et de 50 % en France, comme dans la plupart des pays occidentaux, puis la droite, la baisse à 45 % en 1986, et la gauche continue ce processus jusqu'à 33 % en 93 et 22 % en 2022. Le paradoxe c'est que ce dumping fiscal auquel les États-Unis ont résisté se fait en Europe alors que les pays européens ont le plus besoin de recettes pour financer leur État social. Le traité de Lisbonne reprend le principe de concurrence (« loyauté de la concurrence ») et ne sécurise rien. Et le retour de la gauche au pouvoir ne change rien, puisque la majorité parlementaire ratifie le nouveau traité budgétaire européen en 2012, pourtant critiqué pendant la campagne



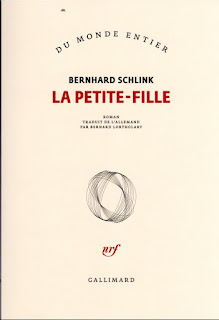
Commentaires
Enregistrer un commentaire